
« Pour mon malheur
Je suis entré
dans cette triste vie
Je n'aime même pas parler
De ma triste
histoire,
La disgrâce remplit mon visage
Et dans mon âme entre le
dégoût,
Mon cœur n'est qu'une blessure
Lorsque je me souviens, messieurs
Du
temps où j'étais innocent
Lorsque je jouais dans les jardins
De mon sertão souriant
je sens que mon cœur
Meurtri par cette passion
Bat et pleure amèrement
Mon père et ma mère chérie
Ont
voulu m'éduquer
Dans leur giron chaleureux
Et elle m'a appris à
prier
Et à respecter tout le monde
Et lui m'a appris dans les champs
À travailler depuis que je suis petit
J'ai grandi dans la maison
paternelle
Je voulais être un homme honnête
Vivre de mon travail
Sans dépendre de personne
J'ai été muletier sur les routes
J'étais
même un bon camarade
Et j'avais aussi des amis
J'ai eu aussi des amours
J'ai entretenu une passion
J'ai aimé une fleur de mimosa
Une fille de mon sertão
J'ai rêvé de pouvoir profiter de la
vie
Aux côtés de ma compagne chérie
À qui j'ai donné mon cœur
Aujourd'hui, je le sais, je suis un
bandit
Comme tout le monde le dit
Mais pourtant j'ai eu de la chance
Et j'ai passé des moments heureux
Lorsque dans le giron maternel
J'ai bénéficié de la tendre
affection
De celle que j'aimais tant
Mon arme tire en chantant
Effrayant instrument
C'est plaisant de se battre contre moi
Parce que je suis un bon chanteur
Et pendant que le fusil travaille
Ma voix résonne au loin
Se moquant de sa propre horreur
On soit obligé de se battre
En dehors des intrigues
J'aimais travailler
Mais aujourd'hui je suis cangaceiro
J'affronterai les embûches
Jusqu'à ce que quelqu'un me tue
Lorsque j'ai pensé que je pouvais
m'en sortir
Il n'y avait pas d'issue
Je vais donner du travail au
gouvernement
L'affronter à visage découvert
Et échanger des
balles sans arrêt
Si je meurs lors d'un combat
Je sais que je
mourrai satisfait. »
Vers de cordel attribués à Lampião (in Élise Grunspan-Jasmin : Lampião, vies et morts d'un bandit brésilien)
Lucas Arvoredo n'avait jamais marché aussi vite. Le nègre Cirilo, qui était allé le chercher et qui lui demandait de se hâter, ne pouvait presque pas le suivre. Ils aperçurent les lumières des feux au début des la soirée. Ils mirent le genou à terre, firent le signe de la croix, ils commençaient à fouler la terre sainte, ils se sentaient purifiés de leurs péchés ; en défendant le beato, ils se rachetaient de leurs crimes.
Lorsque Lucas se releva,
Zè Tonnerre entonna le couplet de ses exploits, et tous
l'accompagnèrent. C'était ainsi qu'ils annonçaient leur arrivée à
Estevao :
« Voici Lucas
Arvoredo
Qui s'amène avec son
fusil... »
La silhouette du
cangaceiro se détachait dans la nuit il n'était pas très
grand, mais il donnait une impression de force peu commune, avec son
costume de cuir, ses cheveux longs, son fusil dressé. Ils se
trouvaient sur un monticule, ce n'était pas tout à fait une
colline, et de là ils apercevaient les feux des soldats. Lucas dit :
- Y a beaucoup de «
singes » à descendre...
Zè Tonnerre jubilait,
rien ne lui plaisait davantage que de tuer un soldat de la police. Et
s'il s'agissait d'un officier, c'était mieux encore. Ils avancèrent,
leur chant dominait peu à peu les voix des pénitents, c'était un
chant de guerre, maintenant les choses avaient changé dans le camp.
Ce fut la dernière nuit de paix.

Cristino Gomes da Silva Cleto alias
Corisco (1907-1940
Quand Lucas arriva, le
beato l'attendait debout, devant le feu, autour de lui se
tenait la foule silencieuse, sale, échevelée et infirme des
pèlerins. Les quartiers de bœuf pour le dîner étaient en train de
rôtir sur les feux et l'odeur de la viande roussie montait dans les
airs. À côté d'Estevao se trouvait Zèfa, Cirilo s'avança, prit
sa place à côté du saint, avant qu'aucun cangaceiro ne
tentât de le faire. Lucas tomba à genoux, mais Estevao le releva :
- Mon fils, tu es arrivé
à temps. Je t'ai fait chercher pasque les hommes mauvais, ils ont
envoyé les soldats pour attaquer les enfants d'Estevao, ceux qui
vont êt' sauvés. Toi aussi, tu vas l'êt', mais toi, et tes hommes,
c'est d'une autre façon. Tu vas lutter, en finir avec les soldats,
Estevao a pas achevé sa mission, il peut pas s'arrêter... Ils
laissent pas venir les pèlerins jusqu'ici pour faire pénitence, ils
les laissent pas passer, comme ça ils restent sans bénédiction,
ils vont êt' tous condamnés... Dieu veut pas de ça, tu vas les
empêcher...
La voix de Zèfa
répétait, en écho :
- Dieu veut pas de ça,
tu vas les empêcher...
Cette voix sembla
familière aux oreilles de Zè Tonnerre. Il chercha à voir clair à
travers les tourbillons de fumée noire. Qui pouvait bien parler
ainsi, d'une voix si connue ? Lucas Arvoredo répondait à Estevao :
- Mon père, je suis ton
fils pour obéir à tes ordres. Y paraît qu'y a beaucoup de soldats,
avec moi ils sont venus quarante-sept hommes ; des munitions, on n'en
a pas beaucoup, mais on en dégotera... Mon père, où tu iras, Lucas
ira aussi et ses hommes avec lui... Mon père, t'as qu'à ordonner et
mes types sont prêts...
- Dieu est content de
ton arrivée...
- Dieu est content de
ton arrivée... répétait Zèfa.
Zè Tonnerre
tressaillit. Il lui semblait que c'était la voix de Marta, c'était
la même intonation, seulement plus âpre, moins cristalline. Qui
était-ce, Seigneur ? Il fit quelques pas en avant.

Barra Nova, Nené, Juruti et un autre cangaceiro non formellement identifié...
Photographie dans la Caatinga, 1936
Photographie dans la Caatinga, 1936
Le beato fit
réunir les fusils des bandits sur le monticule. Et il les bénissait,
la main levée, les yeux perdus, ses yeux bleus qui faisaient peur et
infusaient la confiance. Et la procession reprit. Mais avant qu'elle
se mît en marche, Zè Tonnerre s'approcha et reconnut sa tante
Joséfa. Mais ce n'était plus sa tante folle assaillie par les
esprits, de laquelle ils riaient et se moquaient lorsqu'ils étaient
petits. À présent, elle paraissait autre, elle ne le regarda même
pas, le pas n'existait pas pour Zèfa. À présent, elle était une
sainte presque aussi sainte qu'Estevao, c'était la seconde langue de
Dieu, comme disaient les paysans. Et Zè Tonnerre s'inclina devant
elle et raconta, tout fier, à ses camarades, que c'était sa tante,
qui s'appelait Zèfa et qui, depuis de longues années, répétait
elle aussi que le monde allait finir et qu'il fallait faire
pénitence. Il la regardait comme hypnotisé, et il ne s'apaisa que
lorsque Zèfa posa sa main pleine de cendres sur sa tête et les
répandit sur ses cheveux. Il se sentit pardonné même des
railleries qu'il lui avait adressées, du peu de cas qu'il faisait
d'elle lorsqu'elle était encore dans leur maison ; elle était déjà
une sainte, mais il ne le savait pas.
Les cangaceiros
désignaient Zèfa d'un doigt respectueux :
- C'est la tante de Zè
Tonnerre...
Comme si c'était une
parente à eux tous, une sorte de sainte liée à leur groupe, qui
serait venue spécialement pour les bandits de Lucas Arvoredo. Zè
Tonnerre n'osait même pas demander des nouvelles de Jéronimo et de
Jucundina à sa tante, elle n'appartenait plus à ce monde.
D'ailleurs là, dans le camp, parmi les feux sacrés, les sept puits
bénis, en écoutant les prophéties du beato, ils n'avaient
plus l'impression de vivre dans le monde de tous les jours. C'était
comme une hallucination, il n'y avait plus de frontières entre la
réalité et le rêve.
Lucas réunit ses hommes
et ils dressèrent un plan. Les soldats complétaient le siège.
*

Maria Bonita. Photographie de Benjamin Abrahão, 1936
Ensuite, tout fut très
rapide. Ils étaient bloqués, des sept puits, trois se trouvaient
déjà entre les mains des soldats. Et ils devaient forcer le siège
chaque nuit. Maintenant les soldats partaient escortés par les
hommes de Lucas et les combats se multipliaient, avec des morts des
deux côtés. Mais il arrivait de la viande, les paroles du beato
étaient chaque soir plus violentes, sa voix prenait de nouveaux
sortilèges, et sa bouche, habituellement si douce, écumait. Zèfa
répétait ses phrases, les paysans les gardaient dans leur cœur.
Des renforts arrivèrent pour la police.
Quelques jours passèrent
et les soldats s'emparaient des puits les uns après les autres.
Maintenant, c'était la soif, et Lucas décida de les attaquer et de
les rejeter hors de leurs positions. À la tombée de la nuit, il
réunit vingt hommes. Pendant la journée, il avait étudié la
situation avec Zè Tonnerre. L'un des puits n'était gardé que par
huit soldats. Ce n'était pas le puits le plus grand, mais aucun ne
possédait une eau aussi pure, c'était une source, elle suffirait
pour les besoin du camp.
Ils partirent après la
procession. Ils étaient vingt, choisis parmi les meilleurs tireurs,
ceux qui ne rataient jamais leur cible. Doux-Bec et Sabia, Papillon
et Chi Martins y allaient. Ils marchaient doucement, rampant entre
les broussailles, ils ne faisaient pas plus de bruit que les
serpents. Ils tenaient leur fusil sous le bras, ils épaulèrent. La
fusillade crépita, prit les soldats au dépourvu ; quelques-uns
d'entre eux connaissaient déjà ces hurlements démoniaques, ils
crièrent aux autres :
- C'est Lucas
Arvoredo...
Ils étaient huit
soldats, huit cadavres restèrent autour du puits. Les pèlerins
vinrent et emportèrent de l'eau pour plusieurs jours.
De l'autre côté, le
capitaine entendit la fusillade. Cent trente hommes, ce n'était pas
beaucoup pour ce siège. Mais, avec les renforts, étaient arrivées
vingt mitrailleuses, il valait mieux ne plus attendre, attaquer d'un
seul coup. Sinon Lucas serait capable de regagner des positions mal
garnies, de se frayer un passage, et si lui et le beato
s'enfonçaient dans la caatinga, personne ne pourrait plus les
rattraper. Et alors, c'en était fait des promotions, des citations
l'ordre du jour, des articles élogieux dans les journaux ! Il
rassembla les lieutenants pour discuter.

Lampião, 1936
La nuit suivante, les
soldats essayèrent de récupérer le puits. Mais les hommes de Lucas
ripostèrent et maintinrent leur position. Le capitaine dressait des
plans, inspectait ses soldats, avait des conciliabule avec les
anciens sergents, rompus à la chasse aux bandits. Et ce furent eux
qui lui apprirent qu'il était préférable de combattre en terrain
découvert, de les attaquer dans le camp, au-delà des broussailles.
C'était la seule manière de les vaincre.
- C'est leur talon
d'Achille... - dit un lieutenant timide au capitaine. Mais le
capitaine détestait ces gens pourris de littérature qui faisaient
des phrases et des citations. À l'heure de la lutte, ces gens-là ne
savent que décamper.
D'abord trente hommes
attaqueraient par-derrière. Ils ouvriraient un feu serré, attirant
de ce côté-là les hommes de Lucas. Cinquante autres pénétreraient
alors dans le camp, pour le combat à découvert. Un sergent
conseilla d'attendre une nuit sans lune, cela faciliterait les
mouvements. Avec les renforts, étaient venus aussi des journalistes
de la capitale. Là-bas, le bruit courait que la fin du beato
approchait.

Cangaceiros de la bande de Lampião : Zé Sereno, Azulão et Gato ; 1936
*
La fin approchait, la
fin du monde, disait le beato Estevao. Cette nuit était la
fête de sainte Joséfa, et il avait ordonné à la procession de
faire deux tours au lieu d'un. Zèfa portait des branches de romarin
dans les cheveux et les donnait aux pèlerins qui les mettaient sur
leurs plaies pour les cicatriser.
Le mouvement, dans le
bivouac des soldats, n'avait pas échappé à Lucas Arvoredo. Les
paysans apportaient des nouvelles, les patrouilles de la police
étaient en train d'abandonner leurs positions, les soldats se
regroupaient. Des dizaines d'hommes se dirigeaient vers l'arrière du
camp, protégés par les ombres de là nuit sans lune. Lucas appela
Zè Tonnerre, lui confia vingt hommes et l'envoya de ce côté-là.
- Y veulent attaquer,
ils ont vu qu'ils se font enfoncer dans les petits groupes, ils
veulent voir s'il peuvent nous liquider...
- Tu crois qu'on peut
tenir ?
- On a pas beaucoup de
munitions... Mais si on les tient éloignés, on peut s'ouvrir un
chemin et passe avec le beato.
- Et lui, y veut partir
?
- Y dit que oui... Lui
et douze types, les aut' restent, ils vont se retrouver ensuite...

Maria Bonita. Photographie de Benjamin Abrahão, 1936
Zè Tonnerre avança
avec ses hommes. Les soldats sortaient de la caatinga, Jao
venait avec eux, sous le commandement de ce lieutenant timide qui
citait des phrases. Le capitaine attendait le bruit des détonations
pour ordonner à ses hommes de marcher sur le camp. La consigne était
de tirer sans pitié, sans faire de distinction entre les pèlerins
et les bandits.
Jao était content, car
il avait été choisi pour attaquer par-derrière ; ainsi, il ne
serait pas obligé de tirer contre le saint ni contre les paysans
désarmés : Ils marchaient péniblement entre les broussailles
hérissées d'épines. D'un pas léger et imperceptible, les
cangaceiros, qu'ils croyaient surprendre, arrivaient de
l'autre côté, ils se trouvaient à quelques pas, ils distinguaient
le lieutenant à lunettes, les soldats qui marchaient. Zè Tonnerre
ne vit pas le visage de Jao, remarqua seulement les pantalons kaki de
l'uniforme détesté. II ordonna à ses hommes de se coucher et
d'attendre. Quand les soldats seraient bien près, alors, oui !...
Les bandits se
couchèrent, les canons de leurs fusils étaient glissés entre les
troncs minces des arbustes. La nuit était sombre, sans lune, mais
les yeux de Zè Tonnerre savaient voir clair dans les ténèbres. Il
repérait les jambes du soldat qui marchait. Il ne savait pas que
c'était son frère Jao, celui qui était parti le premier. Il
calculait d'après son pas le moment où il leur faudrait sauter et
tirer, pousser leurs hurlements horribles, leur cri de guerre. C'est
maintenant. Un signal qui passe d'homme en homme. Et les hurlements
déchirent la caatinga, ce sont des rugissements d'animaux en
furie, impressionnants à faire arrêter le cœur. Zè Tonnerre leva
son arme, dans l'éclair du coup de feu, Jao aperçut son visage.
C'était son frère José, et il murmura son nom, mais Zè Tonnerre
partait en avant, les cangaceiros tiraient. Jao voyait les
soldats courir ; il entendait la voix du lieutenant criant des
ordres, mais il entendait tout très bas, et il voyait à travers un
nuage qui recouvrait ses yeux. La seule chose qu'il voyait
parfaitement, c'était le visage de son frère José, la bouche
ouverte dans un cri, les yeux serrés de colère, de José appuyant
sur la gâchette de son fusil. Et, au moment même où il mourait,
Jao comprit que José était le fameux Zè Tonnerre, lieutenant de
Lucas Arvoredo. Et il eut encore le temps de lui souhaiter la vie
sauve, et au beato aussi, ah ! au beato surtout !
Les coups de feu
continuaient à crépiter, en face du camp résonnaient les pas des
soldats marchant pour l'assaut décisif. Zè Tonnerre poussait ses
cris de guerre. Jao était mort en souriant.

Maria Cristina Haize ; huile sur toile
*
[Elle était blanche, un peu brune
Ses lèvres couleur de rose
Ses yeux immenses, brillants
Comme étoiles lumineuses
Elle possédait la symétrie
La grâce et le charme
D'un bijou précieux
Son buste était sculpté
Avec soin et amour
De la main mystérieuse
De l'artiste suprême
Qui, avec de tendres caresses, a créé
Des jambes parfaites
Chacune d'entre elles était une fleur
Pourtant, Maria Bonita
Avait un cœur aussi dur
Qu'elle était belle
Comme elle était habile
À monter l'âne et le cheval
On n'entendait que le claquement du
fouet
Et le tremblement du sol
Maria, lorsque elle était jeune
fille
Était la fleur des environs
Nombreux furent les garçons
Qui pleurèrent de tristesse
Parce qu'elle leur parlait ainsi :
Un jour, je n'épouserai
Que celui qui ne sera pas un lâche
J'épouserai un homme
Qui montre
qui il est
Avec ses poings, avec ses pieds
Avec son poignard, avec
son couteau
Avec les balles de son fusil
Jusqu'à faire sauter les
têtes. »
Extrait du poème d'Antonio Teodoro dos Santos : Maria Bonita, a mulher cangaço ]

Maintenant la fusillade
était serrée dans le camp. Les soldats y avaient fait irruption, le
beato s'était retiré avec Zèfa et les pèlerins dans le
cercle formé par les feux, il avait commencé à prêcher comme si
de rien n'était. Les balles abattaient des hommes, les gémissements
se mêlaient à ses paroles, Cirilo épaulait sa carabine derrière
Estevao. Dans la clairière Lucas et ses hommes faisaient face aux
soldats, mais ils ne savaient pas se battre de cette façon. Et
lorsque Lucas tomba, blessé à la tête, ses hommes lâchèrent
pied. À reculons, ils parvinrent auprès du beato, ils
s'arrêtèrent devant les pèlerins.
Les soldats avançaient, une quinzaine étaient déjà tombés, morts ou blessés, mais les pertes chez les cangaceiros étaient plus importantes. Dans l'ardeur du combat, des deux côtés, le désir de tuer augmentait. Les pèlerins ramassaient les armes de ceux qui tombaient, prenaient leur place. Les soldats tiraient indistinctement sur les bandits et sur les paysans ; ceux qui étaient nés dans la ville cherchaient à viser le saint, autour duquel s'amoncelaient les cadavres.
Les soldats avançaient, une quinzaine étaient déjà tombés, morts ou blessés, mais les pertes chez les cangaceiros étaient plus importantes. Dans l'ardeur du combat, des deux côtés, le désir de tuer augmentait. Les pèlerins ramassaient les armes de ceux qui tombaient, prenaient leur place. Les soldats tiraient indistinctement sur les bandits et sur les paysans ; ceux qui étaient nés dans la ville cherchaient à viser le saint, autour duquel s'amoncelaient les cadavres.
À présent, on luttait
corps à corps, les bandits dégainaient leurs poignards, on
entendait les coups de feu de Zè Tonnerre contre les soldats qui
avaient attaqué à l'arrière.

Lunettes ayant appartenu au cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, alias Lampião
Un soldat visa la
poitrine du beato et sa balle partit en même temps que celle
de Cirilo, le beato roula sur le corps des pèlerins, le
soldat tomba sur le sol où les braises se dispersaient. Alors Cirilo
s'avança, il avait lâché sa carabine, saisi son poignard. Un
soldat prit Zèfa par un bras, elle se débattit, le mordit et le
griffa, elle lui donnait des coups de pied, lui crachait à la
figure. Il frappa sur son visage avec la crosse de son fusil,
lorsqu'elle tomba, le soldat abaissa son arme et la déchargea.
Zè Tonnerre arriva
ensuite, après avoir liquidé des soldats. Mais ce fut pour voir les
cangaceiros survivants s'enfuir, tout en venant à sa
rencontre ; ils lui dirent que Lucas et Estevao étaient morts. Sa
tante Zèfa aussi.
Ils le regardaient,
attendant des ordres. Des vingt hommes qu'il avait emmenés avec lui,
quatre avaient été mis hors de combat. Et une dizaine seulement
venait du camp, il n'y avait plus rien à faire. Ils battirent
rapidement en retraite, déjà les soldats les poursuivaient, mais Zè
Tonnerre atteignit la caatinga à temps. En passant, il marcha
sur le visage d'un soldat. Il lança un juron, mais Jao souriait
toujours, même du juron de son frère.

Maria Bonita ; vers 1936-1937
Le sertao oublia le nom
du beato Estevao, oublia le nom de Lucas Arvoredo. Mais le nom
de Zè Tonnerre devint de plus en plus célèbre, sa cruauté et ses
crimes laissèrent loin derrière eux tous les cangaceiros qui
l'avaient précédé dans la caatinga. On disait de lui qu'il
n'avait pas de cœur, qu'on n'avait jamais vu un homme aussi
impitoyable, pas même Virgulino Ferreira Lampiao. II ne fit
jamais grâce à un soldat, il n'accorda jamais une réduction sur
les impôts qu'il levait dans les villes attaquées. La chanson
disait de lui :
« Tonnerre vient
d'arriver
Beaucoup de sang va
couler... »
*

Têtes coupées de Lampião (en bas), de Maria Bonita, sa compagne (au-dessus de celle de Lampião)
et de neuf de leurs compagnons ; 28 juillet 1938 (10 Thermidor...)
Par ordre du capitaine,
ils coupèrent la tête du beato Esteyao, de Lucas Arvoredo,
de Zèfa et de quelques pèlerins, pour augmenter le nombre. Ils les
emportèrent comme des trophées, les exhibèrent en ville, des
centaines de curieux défilèrent devant. Le capitaine fut élevé en
grade, cité à l'ordre du jour, et, bien qu'il n'aimât pas la
littérature, il écrivit un livre sur la campagne.
Dans le campement, à
l'aube, les cadavres étaient amoncelés. Avec la chaleur, ils
commençaient à pourrir. Des urubus arrivèrent de tous les
points de caatinga et couvrirent le soleil de leurs ombres
noire. L'obscurité était si grande qu'on aurait cru proche la fin
du monde.
Jorge Amado (1912-2001) ; Seara vermelha, roman, 1946 : Les Chemins de la faim, trad. par Violante do Canto, Les Éditeurs français réunis, Paris, 1951, 383 p.

Oeuvre de Jayme Griz, Rio Una, 1951

Monument funéraire à la mémoire de Lampião et ses compagnons au lieu où ils fûrent assassinés
« Afin que cela constitue une
preuve irréfutable
On coupa les têtes
De tous les cangaceiros
Puis
on les mit
Avec de l'eau salée dans une boîte
De kérosène, puis
on les a amenées
Emportant les onze têtes
Les
policiers quittèrent
Angico, puis ils traversèrent
Le grand fleuve
Sâo Francisco
En direction de l'Alagoas
Et arrivèrent à Sant'Ana
A Sant'Ana do Ipanema
Eut lieu l'exposition des têtes
Et le peuple
De presque tout le sertão
Vint
voir les têtes
Des cabras de Lampião
On fit cela parce que dans le
Nordeste
On parlait sans cesse de Lampião
On disait qu'il était
invincible
Et qu'il avait le corps fermé
À l'abri des poignards, des
couteaux et des balles
Et qu'il était protégé des morsures de
serpents
On raconte qu'il avait quelque chose
à voir avec Dieu
Et aussi avec le Diable
Personne ne croyait
Qu'il
ait pu perdre la vie
Qu'il puisse jamais mourir de blessures
Plutôt
que de malemort. »
Manoel d'Almeida Filho : extrait du cordel "Os Cabras de Lampião"

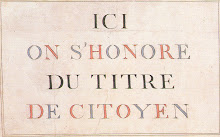







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire