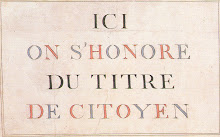Les années suivantes voient Billie Holiday multiplier les enregistrements, les engagements, les succès, avec des musiciens de la stature de Roy Eldridge, Art Tatum, Benny Carter, Dizzy Gillespie… Mais elle entame également une liaison avec Jimmy Monroe, pour qui elle quitte le domicile de sa mère, avant qu'ils ne se marient précipitamment. Son nouveau compagnon est un escroc, doublé d'un drogué. Il l'habitue à l'opium, puis à la cocaïne, avant de se retrouver en prison.
Billie divorce de Monroe et enchaîne de nouveau les aventures, jusqu'à sa rencontre avec Joe Guy, un trompettiste be-bop qui la fournit en héroïne. À l'époque même où elle est la première artiste noire à chanter au "Met", où elle signe un contrat en or chez Decca, elle se retrouve sous la coupe de Joe Guy, dépendante à l'héroïne… Billie en parle sans concession :
« Je suis rapidement devenue une des esclaves les mieux payées de la région, je gagnais mille dollars par semaine, mais je n'avais pas plus de liberté que si j'avais cueilli le coton en Virginie.»
Dans les clubs, il se murmure qu'elle ne respecte pas ses engagements, qu'elle est souvent en retard, qu'elle se trompe dans les paroles. En 1945, Joe Guy monte une grande tournée pour Billie : "Billie Holiday and Her Orchestra". La tournée est déjà bien entamée lorsque Billie apprend la mort de sa mère Sadie, Duchess, comme l'avait surnommée Lester. Billie est effondrée, elle sombre dans la dépression, elle se réfugie un peu plus dans l'alcool, la drogue, et écourte sa tournée.
Au lendemain de la guerre, Billie Holiday est au plus haut, elle entame sa collaboration avec le pianiste Bobby Tucker, ses disques se vendent bien (elle a signé en 1944 chez Decca, elle triomphe au Town Hall de New York en février 1946, et son répertoire s'élargit à quelques chansons indissociables de son personnage : Lover Man, Good morning Heartache (écrite pour elle par Irene Wilson), et ses propres compositions : Fine and Mellow, Billie's Blues, Don't Explain et God Bless the Child. Elle tourne aussi dans le film New Orleans d'Arthur Lubin, un long-métrage assez médiocre, mais qui réunit de grands jazzmen, dont Louis Armstrong et Woody Herman.
À la même époque elle renoue avec Joe Guy et adopte le LSD. Son imprésario Joe Glaser lui impose une cure de désintoxication dans une clinique privée, début 1947. En vain : quelques semaines plus tard elle est arrêtée en possession de stupéfiants et condamnée à un an de prison. Billie fait scandale, et se trouve de plus dans une situation financière difficile : ses royalties ont disparu dans la drogue et les poches des hommes qui l'entourent… Elle sort de prison le 16 mars 1948, pour bonne conduite, mais ruinée. Le 27, elle chante à Carnegie Hall, plus belle que jamais, la voix épanouie, ses éternels gardénias dans les cheveux. Elle chante jusqu'à l'épuisement : vingt et une chansons, plus six pour les rappels. Un triomphe.
Depuis sa sortie de prison, Billie s'est vue retirer sa carte de travail pour avoir enfreint les critères de « bonne moralité ». Elle ne peut plus chanter dans les clubs de New York (ou tout endroit vendant de l'alcool). Seule alternative, les grandes salles de concert : difficile d'en remplir les travées plus d'un ou deux soirs de suite. Par ailleurs elle est impliquée dans une bataille d'agents, entre Joe Glaser et Ed Fishman, qui s'occupe désormais d'elle.
Malgré tout, Billie se produit avec Lionel Hampton à la radio, et avec Count Basie au Strand Theatre. Elle sort désormais avec John Levy, gangster de seconde zone que l'on surnomme par dérision « Al Capone ». A l'époque, elle entretient également une relation lesbienne avec Tallula Bankhead, comédienne de bonne famille, et a une courte relation sexuelle avec Marlene Dietrich. Cependant, Billie est toujours plongée dans l'héroïne, et le retrait de sa carte la force à chanter hors de New York, des engagements moins intéressants et moins bien rétribués. En outre, John Levy amasse désormais tout ce qu'elle gagne et la terrorise. Elle se fait prendre en possession de stupéfiants à San Francisco. En réplique, Tallulah Bankhead fait jouer ses relations, dont J. Edgar Hoover, alors directeur du FBI, grâce à quoi Billie est acquittée. Malgré cela les ennuis persistent : elle subit toujours les violences de John Levy, son accompagnateur et ami Bobby Tucker l'abandonne, la police la suit de près et elle manque plusieurs fois de se faire prendre en possession d'héroïne… La presse ne manque pas une occasion de titrer sur elle, comme Down Beat en septembre 1950 : « Billie, de nouveau dans les ennuis ».
Lors d'un enregistrement en 1949 pour Decca, avec notamment Horace Henderson, Lester Young et Louis Armstrong, Billie a bien du mal à tenir le rythme, elle se fait remarquer par ses retards, ses excès, et une diction de plus en plus empâtée par l'alcool. Decca ne renouvelle donc pas son contrat en 1950, Billie est plongée dans les dettes jusqu'au cou : John Levy, qui encaisse ses cachets, n'a payé aucune facture. Lorsqu'elle le quitte, elle perd beaucoup d'argent, mais retrouve une certaine liberté. Billie reste toutefois contrainte à faire de longues tournées puisqu'elle ne peut toujours pas chanter à New York. Fin 1950, elle renoue avec le succès à Chicago, en partageant l'affiche du Hi-Note avec le jeune Miles Davis.
En 1951, Billie Holiday trouve une petite maison de production, Aladdin, pour laquelle elle enregistre quelques disques, mal reçus par les critiques. Elle rencontre également à Detroit un de ses anciens amants, Louis McKay, qu'elle avait connu à Harlem quand elle avait 16 ans. Marié et père de deux enfants, Louis McKay devient néanmoins son nouveau protecteur et contribue à relancer sa carrière. Elle s'installe sur la côte ouest, et signe un contrat pour le label Verve de Norman Granz. Elle retrouve alors des partenaires dignes d'elle : Charlie Shavers à la trompette, Barney Kessel à la guitare, Oscar Peterson au piano, Ray Brown à la contrebasse, Alvin Stoller à la batterie et Flip Philips au saxophone. Résultat : le disque Billie Holiday sings obtient un franc succès et est suivi de plusieurs autres sessions. Billie se voit néanmoins de nouveau refuser son permis de travail et alterne les tournées fatigantes et les grands concerts (à l'Apollo, à Carnegie Hall).

1954 voit Billie réaliser un vieux rêve : sa première tournée en Europe. Accompagnée de Louis McKay et de son pianiste Carl Drinkard, elle se rend en Suède, au Danemark, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, à Paris, en Suisse. Elle repasse par Paris en touriste, avant de rejoindre l'Angleterre où ses concerts sont couronnés de succès. Une tournée fructueuse et l'un des meilleurs souvenirs de Billie. De retour au pays, malgré la drogue, malgré l'alcool, elle se surpasse. Elle se produit à Carnegie Hall, au festival de jazz de Newport, à San Francisco, à Los Angeles, et continue d'enregistrer pour Verve. Down Beat lui décerne un prix spécialement créé pour elle. Elle embauche aussi une nouvelle accompagnatrice, la jeune Memry Midgett. Leur relation est plus qu'amicale, et Memry aide Billie dans ses tentatives pour décrocher de la drogue. En vain. Son influence ne plaît d'ailleurs pas à McKay qui la fait déguerpir.
Le 2 avril 1955, Billie Holiday retrouve Carnegie Hall où elle participe au grand concert en hommage à Charlie Parker, mort le 12 mars. Aux côtés de Sarah Vaughan, Dinah Washington, Lester Young, Billy Eckstine, Sammy Davis Jr., Stan Getz, Thelonious Monk… Billie clôt le concert, aux alentours de quatre heures du matin. En août 1955, elle enregistre un nouvel album pour Verve : Music for Torching, un chef d'œuvre qu'elle réalise en compagnie de Jimmy Rowles au piano, Sweets Edison à la trompette, Barney Kessel à la guitare, Benny Carter à l'alto, John Simmons à la basse et Larry Bunker à la batterie. Puis, elle retrouve les clubs de la côte ouest.
En 1956, Billie est arrêtée avec Louis McKay en possession de drogue : un nouveau procès est prévu. Elle effectue une nouvelle cure de désintoxication, à l'époque où sort son autobiographie Lady Sings the Blues, pour l'essentiel une compilation de toutes ses anciennes interviews réunies par le journaliste William Dufty, admirateur de la diva. La santé de Billie se dégrade de plus en plus. Sa nouvelle pianiste, Corky Hale, témoignera plus tard du calvaire de Billie : son épuisement, les ravages de la drogue et de l'alcool, les longues manches pour cacher les traces de piqûres qui lui couvrent même les mains, la fatigue, la perte de poids, l'ivresse avant les concerts. La perspective de son procès avec McKay la terrorise. Enfin, ce dernier se consacre moins à elle…
Elle apparaît au festival de Newport, ainsi qu'à la télévision, dans l'émission The Sound of Jazz, sur CBS, en compagnie, entre autres, de Lester Young, Coleman Hawkins, Ben Webster, Gerry Mulligan et Roy Eldridge, mais aussi du jeune Mal Waldron, son nouvel accompagnateur.
Louis McKay et Billie se marient le 28 mars 1957 au Mexique, pour ne pas avoir à témoigner l'un contre l'autre lors de leur procès. Mais leur histoire est bel et bien terminée. Une fois le jugement prononcé (une mise à l'épreuve de douze mois), McKay quitte définitivement Billie et celle-ci engage une procédure de divorce. Elle enregistre Lady in Satin en février 1958, avec des chansons entièrement nouvelles et un orchestre dirigé par Ray Ellis, auteur des arrangements. Un album poignant, de même que son tout dernier, simplement intitulé Billie Holiday, enregistré début 1959. Elle fait également une apparition au festival de jazz de Monterey en octobre 1958, et effectue une nouvelle tournée européenne au mois de novembre. Elle est sifflée en Italie, où sa prestation est abrégée. À Paris, elle assure à grand-peine un concert à l'Olympia, exténuée. Sa tournée prend l'eau. Elle accepte de jouer au Mars Club avec Mal Waldron et Michel Gaudry à la contrebasse : le public est tout acquis à Billie qui y retrouve le succès. On se bouscule dans le Mars Club, on y retrouve les célébrités de l'époque : Juliette Gréco, Serge Gainsbourg, ou encore Françoise Sagan qui écrira :
« C'était Billie Holiday et ce n'était pas elle, elle avait maigri, elle avait vieilli, sur ses bras se rapprochaient les traces de piqûres. […] Elle chantait les yeux baissés, elle sautait un couplet. Elle se tenait au piano comme à un bastingage par une mer démontée. Les gens qui étaient là […] l'applaudirent fréquemment, ce qui lui fit jeter vers eux un regard à la fois ironique et apitoyé, un regard féroce en fait à son propre égard. » — Françoise Sagan, Avec mon meilleur souvenir, Gallimard, 1984
Depuis plusieurs années déjà, Billie est malade. Elle a des œdèmes aux jambes, mais aussi et surtout une cirrhose avancée. Pourtant elle ne modère pas ses excès. Elle boit du matin au soir. Épuisée par sa deuxième tournée européenne, elle repart quelques mois plus tard à Londres pour participer à une émission de télévision, "Chelsea at Nine". Le retour est difficile. Billie apprend le 15 mars 1959, le décès de son ami, Lester Young. Billie est effondrée. Le 7 avril suivant, elle fête ses 44 ans. Elle assure des engagements dans le Massachusetts, puis le 25 mai, elle chante au Phoenix Theatre de New York, pour un concert de bienfaisance. Dans les coulisses, ses amis ne la reconnaissent même pas. Certains, dont Joe Glaser, veulent la faire hospitaliser : elle refuse. Le 30 mai, elle s'effondre chez elle et est admise au Metropolitan Hospital de Harlem.
Outre sa cirrhose, on diagnostique une insuffisance rénale. Elle est traitée sous méthadone et se remet peu à peu. On lui interdit l'alcool et la cigarette, mais Billie trouve toujours un moyen de fumer en cachette. Voire pire : le 11 juin, on découvre un peu de poudre blanche cachée dans une boîte de mouchoirs. Billie Holiday est arrêtée et sa chambre mise sous surveillance policière pendant plusieurs jours. On prévoit de la juger après sa convalescence. Celle-ci semble se passer au mieux, mais le 10 juillet, son état s'aggrave. On décèle une infection rénale et une congestion pulmonaire. Louis McKay et William Dufty sont à son chevet. Elle reçoit les derniers sacrements le 15 juillet. Le 17 juillet, à trois heures dix du matin, Billie Holiday meurt à l'hopital.
La cérémonie funèbre se déroule le 21 juillet 1959 en l'église St. Paul. Trois mille personnes sont présentes et se bousculent jusque dans Columbus Avenue. Elle est enterrée au cimetière St. Raymond, dans le Bronx, dans la même tombe que sa mère. Louis McKay fait déplacer son cercueil dans une tombe séparée en 1960. À sa mort, Billie laisse à son ex-mari et seul héritier, mille trois cent quarante cinq dollars. Et ses droits : à la fin de 1959, en seulement six mois, les royalties sur ses ventes de disques s'élèvent à cent mille dollars. De quoi avoir une bonne idée de ce que Billie a pu dépenser aussi bien que de tout ce dont elle a pu être spoliée.*


Don't Know if I'm Coming Or Going
Les journaux ont titré : « Les États-Unis d'Amérique contre Billie Holiday », et c'était ça.
On m'a conduite dans une salle d'audience du tribunal de district, au croisement de la 9e Rue et de Market Street, à deux pâtés de maisons de l'Earle Theatre où tout avait commencé onze jours auparavant. Ces deux pâtés de maisons étaient pour moi comme l'océan Atlantique. C'était le mardi 17 mai 1947.
On m'a lu l'acte d'accusation : « Le, ou aux environs du 16 mai 1947, et à diverses autres dates avant cela, dans le district Est de l'État de Pennsylvanie, Billie Holiday a reçu, recelé, transporté et facilité le transport et le recel de ... stupéfiants ... illégalement introduits aux États-Unis en violation de la Constitution, article 174, alinéa 21. »
Un substitut du procureur a pris la parole :
-Eh bien ! Billie Holiday, vous êtes accusée d'avoir violé la loi sur les stupéfiants, copie de l'acte d'accusation vous a été montrée et vous avez manifesté le désir de renoncer à comparaître devant le Grand Jury. Vous avez cependant droit à un avocat.
J'ai répondu :
- Je n'en ai pas.
Le procureur m'a demandé :
- Miss Holiday, désirez-vous un avocat ?
- Non.
J'étais persuadée que personne ne voudrait m'aider, et pire, que personne ne le pouvait.
- Bien. Voici une renonciation à votre droit d'être défendue. Veuillez signer sur cette ligne.
On m'a passé un papier rose, et j'ai signé. J'aurais signé n'importe quoi, n'importe comment, je
ne mangeais rien depuis une semaine et ne pouvais même pas avaler de l'eau ; chaque fois que je m'assoupissais, une espèce de mastodonte venait me chercher pour que je signe un papier, que je m'habille ou que je change de bureau. Le jour de l'audience, je ne tenais plus debout, je n'étais absolument pas en état de me présenter devant le juge. Alors ils ont décidé de me filer quelque chose pour me soutenir : une piqûre de morphine.
Le juge a pris la parole pour demander :
- Cette femme est-elle assistée par un avocat ?
Le procureur a répondu :
- J'ai reçu aujourd'hui un appel téléphonique d'un avocat qui l'a déjà défendue, je lui ai expliqué l'affaire : celle-ci ne l'intéresse pas et il souhaite qu'elle suive son cours sans son intervention.
En clair, ça voulait dire que personne au monde ne se souciait de moi à ce stade.
Lorsqu'une femme noie son enfant, ce qui est le pire des crimes, elle a tout de même droit à un avocat, et moi-même j'aiderais une telle femme, si je le pouvais.
Je ne pouvais guère compter sur le secours de l'assistance juridique gratuite, étant donné que je gagnais plus de deux mille dollars par semaine. J'étais totalement seule, puisque Glaser m'avait dit :
- Ma fille, la taule c'est ce qui peut t'arriver de mieux.
J'avais besoin de me faire soigner, et lui m'envoyait à l'abattoir.
Ils m'ont tendu de nouveau un formulaire blanc à signer :
- Voici votre renonciation à votre droit de passer devant le Grand Jury, Miss Holiday.
Rien n'a jamais été si simple pour eux. J'ai signé, ils s'occupaient du reste ; je n'étais que le dindon de la farce.
- Que plaidez-vous ? A demandé l'assesseur.
- Je désire plaider coupable et être envoyée dans une clinique.
Le procureur a prononcé son réquisitoire en ces termes :
- Si votre Honneur le permet, nous sommes ici en présence d'une affaire de drogue, beaucoup plus grave cependant que dans la plupart des cas. Miss Holiday est une chanteuse professionnelle, de premier plan si l'on en juge d'après ses revenus. Elle s'est produite à Philadelphie sur la scène de l'Earle Theatre, où elle avait un engagement d'une semaine, nos agents de la Brigade des stupéfiants ont été avisés par notre service de Chicago qu'elle s'adonnait à l'héroïne et en avait sur elle sans aucun doute.
- Chicago vous en a avisés ? a demandé le juge.
- Exactement, a répondu le procureur. L'inculpée y avait préalablement séjourné. Après vérification, il a été établi qu'en quittant l'Earle Theatre ou s'apprêtant à le quitter, elle avait en sa possession des sachets ... qu'elle a confiés à un homme que l'on suppose être son manager, du nom de James Asundio. Subséquemment, au moment où James Asundio et Boby Tucker faisaient leurs bagages, nos agents se sont présentés à l'hôtel, ont indiqué la raison de leur présence et Asundio a affirmé que cette chambre était la sienne. Avec son accord il a été procédé à une perquisition qui a permis de découvrir un paquet dissimulé dans une doublure de soie et contenant des sachets d'héroïne ...
Il a continué :
- ... Subséquemment, Miss Holiday a été appréhendée à New York. Elle a passé des aveux complets et lors de son arrivée la semaine dernière en compagnie de son imprésario Glaser, a exprimé le désir de subir une cure de désintoxication. Malheureusement pour elle, elle a toujours été entourée de la pire espèce de parasites et d'escrocs. L'enquête a établi que durant ces trois dernières années elle a gagné près de deux cents cinquante mille dollars, cinquante-six à cinquante-sept mille pour la seule année passée, et il ne lui en reste pas un centime. Ses compagnons de voyage, a continué le jeune procureur avec emphase, étaient ses pourvoyeurs : ils achetaient la drogue entre cinq et six dollars pour la lui revendre entre cent et deux cents, à quantité égale. À notre avis, la meilleure chose que l'on puisse faire pour elle est de la faire hospitaliser afin d'être correctement soignée et, peut-être, désintoxiquée définitivement.
Puis le juge a pris la parole. Il m'a demandé mon âge, si j'étais mariée, depuis combien de temps j'étais séparée de mon mari, si j'avais des enfants, où je travaillais, bref de lui raconter ma vie privée et professionnelle. Il m'a demandé encore si je savais qu'il était interdit de prendre des stupéfiants. Qu'est-ce qu'il voulait que je lui dise ? Je lui ai répondu que je ne pouvais plus m'en passer. Puis il a voulu savoir quelle dose je prenais ; l'agent fédéral Roder le lui a précisé, et il lui a demandé si c'était une forte dose. L'autre a répliqué qu'elle aurait suffi à le tuer. Il n'en serait pas mort, en fait : il aurait plané, c'est tout.
Ensuite, il a voulu savoir aussi avec quelle quantité j'avais commencé : putain, je n'étais pas plus pharmacienne que lui ! J'en avais marre de ces vieux birbes qui prenaient leur pied avec ça. On m'avait dit que si je plaidais coupable, on m'enverrait à l'hosto ; je n'en pouvais plus et c'était tout ce que je voulais. Toute leur parlotte me gonflait. Je l'ai arrêtée net et me suis adressée au juge :
- Je veux aller en clinique, Votre Honneur.
- Je sais, a-t-il répondu distraitement.
- Je veux me soigner.
- Vous êtes ici sous l'inculpation d'usage de stupéfiants, a-t-il prononcé en me regardant droit dans les yeux.

Puis, lui et les fédéraux sont entrés dans une série de palabres dont je n'avais rien à foutre ; le commissaire de Philadelphie est venu à la barre brosser un tableau merveilleux de leur façon de travailler, et a terminé ainsi :
- Je n'ajouterai qu'un mot : il ne nous serait d'aucune utilité de condamner l'accusée si ce n'est dans son intérêt propre, à moins de pouvoir par là remonter toute la filière.
Le juge avait l'air de dire qu'on me faisait une faveur, et a continué à parler de culpabilité et de condamnation sans que personne songe à le contredire. Il a recommencé à me poser des questions sur mes tournées, les gens qui m'accompagnaient, l'argent que je gagnais, les lieux où ça se passait. Ça aurait pu continuer longtemps si quelqu'un n'était pas venu tenir un conciliabule avec lui. Ça devait être un délégué à la liberté surveillée, ou un type de l'Assistance sociale ou du même genre.
Enfin, le juge a réclamé le silence.
- Je veux que vous compreniez bien, ainsi que je vous l'ai signifié au cours du procès, que vous êtes ici en tant qu'accusée et, bien que vous soyez actuellement dans un état lamentable, nous ne doutons pas, étant donné les neuf ans que vous avez passés dans le monde des artistes, de votre capacité à démêler le bien du mal : vos expériences ont été nombreuses, comme j'ai pu m'en apercevoir. Il faut que vous sachiez que vous êtes coupable d'un acte criminel ; vous ne serez pas en principe envoyée dans une clinique de désintoxication. On vous soignera, mais je veux que vous preniez conscience que vous êtes condamnée pour un grave délit ; pour le moment, nous ne poursuivrons pas les autres malfaiteurs coupables de complicité avec vous. Durant votre détention vous vous rendrez compte par vous-même de la qualité du traitement qui vous sera administré : c'est la contribution financière que le gouvernement veut bien vous accorder dans ce cas précis. Je ne crois pas que vous ayez dit toute la vérité au sujet de votre accoutumance aux stupéfiants... Vos conditions de détention dépendent avant tout de vous-même, de l'administration pénitentiaire et du gouvernement, et nous espérons qu'au terme de votre incarcération, vous vous serez réhabilitée et retournerez à la société comme un individu utile pour reprendre votre place dans le métier que vous avez choisi et dans lequel vous avez réussi. La Cour vous condamne à une peine d'emprisonnement d'un an et un jour. Monsieur le Procureur général désignera la prison où vous devrez accomplir cette peine.
Tout a été expédié en quelques minutes ; on m'a fait une autre piqûre pour m'éviter d'être malade dans le train, et à vingt et une heure, je gisais sur la couchette supérieure d'un train filant vers la Maison Fédérale de Redressement pour Femmes à Alserson, en Virginie avec deux grosses matrones pour me surveiller.
Elles se comportaient comme si elles avaient peur de moi. Quand j'ai demandé à l'une d'elle de m'apporter une bouteille de bière, elle en a eu le souffle coupé et m'a dit que c'était contraire au règlement. Et la dose de came qu'on m'avait injectée pour me faire tenir le coup, bordel, ce n'était pas contraire au règlement ?
Personne n'avait envie de courir le risque de me voir à l'article de la mort dans le train : une gardienne a fini par céder et m'a ramené une petite canette de bière.
Mais le roman de Philadelphie n'était pas terminé.
Ils m'ont fait faire l'aller-retour Alderson-Philly pour m'interroger ; j'avais la haine : ils me trimbalaient si souvent que les autres filles commençaient à me prendre pour une moucharde. Et il n'y a rien de pire que la prison de Philadelphie où il me gardaient. C'est pire que Welfare Island, constamment humide, plein de rats aussi gros que mon chihuahua. Il y avait là des femmes tuberculeuses ou plus gravement atteintes encore, qui purgeaient des peines à vie pour meurtre ou n'importe quoi, et moi, je devais manger et dormir avec elles.
Quand ils estimaient qu'ils ne m'avaient pas assez cuisinée, ils me faisaient venir à Philadelphie le vendredi soir et je restais dans cet enfer jusqu'au lundi avant d'être interrogée. On parle des lavages de cerveau, je sais ce que c'est.
Le plus terrible, c'est qu'ils m'ont confrontée à Jimmy Asundio, et quelques temps après à Joe Guy. Ils avaient tous les deux de bons systèmes de défense, de bons avocats, et ils s'en sont tirés. L'arrêt rendu contre Jimmy a été annulé en cour de cassation parce que les fédéraux avaient pénétré dans sa chambre sans mandat. Quant à Joe Guy, le jury l'a acquitté en quelques minutes. Il n'y avait pas de motif d'inculpation, c'était l'avis du juge et le jury a suivi.
Comme toujours, moi, j'étais la pauvre conne.
Les gens qui se droguent sont des malades. Et à l'heure actuelle on en arrive à un résultat aberrant, c'est que le gouvernement poursuit les malades comme si c'étaient des criminels, interdit aux médecins de les soigner, les traduit en justice pour détention illégale de drogue et les fiche en taule.
Imaginez que le gouvernement fasse la même chose aux diabétiques, décide d'un impôt sur l'insuline, se rendant ainsi responsable du développement d'un marché noir de ce médicament, interdise aux médecins de soigner le diabète, poursuive les malades qui se sont procuré le produit et les mette en prison. Tout le monde crierait au fou. C'est pourtant ce qui se passe tous les jours avec les gens accrochés à la drogue. Les prisons en sont pleines et le problème se complique de jour en jour.
Billie Holiday - Lady sings the blues, 1956
* Les textes introductifs sont tirés de l'article de Wikipedia