Eleanora Fagan naît à Baltimore en 1915. Sa mère, Sadie Fagan, a 19 ans et son père, Clarence Holiday, en a 17. Dans Lady Sings the Blues, Billie Holiday, réécrivant son histoire, enlève quelques années à son père, plus encore à sa mère, et en fait un couple marié. C'est l'une des nombreuses déformations de la réalité que Billie elle-même entretenait et dont son autobiographie a prolongé les effets. La réalité est un peu moins idyllique. Clarence et Sadie ne se sont jamais mariés. Clarence Holiday ne reconnaît pas l'enfant, il est guitariste de jazz, et passe sa vie dans les clubs la nuit, sur les routes le jour. Sadie, sa mère, n'a pas le temps de s'occuper d'Eleanora et la confie à sa famille : la fillette va d'un foyer à l'autre tandis que sa mère enchaîne les petits boulots à Baltimore, tout en voyageant souvent à New York où elle multiplie les rencontres masculines, en général rétribuées.
La petite Eleanora n'a pas la vie aussi facile : elle endure les violences de sa tante Ida, et subit un premier traumatisme : un jour, alors qu'elle fait la sieste dans les bras de son arrière grand-mère, celle-ci meurt dans son sommeil. Eleanora se réveille étranglée par les bras de la morte et panique. Elle restera plongée dans un mutisme coupable pendant des semaines.
Sadie reprend Eleanora à sa charge après quelques années. Elle a dix ans lorsque, pendant l'une des nombreuses nuits que sa mère passe dehors, elle est violée par un voisin. Elle est par la suite confiée au couvent du Bon Pasteur, où les maltraitances et les humiliations sont monnaie courante. Sadie parvient à en faire sortir sa fille et la reprend avec elle, à New York où elles vivent désormais. En 1928, Sadie se prostitue et installe Eleanora dans un bordel. La vie de la jeune fille est faite d'hommes, de violences, d'un détour en prison. En plein Harlem, sous la prohibition, Eleanora découvre les boîtes clandestines, où l'alcool coule à flots et où le jazz résonne du soir au matin. Presque par hasard, Eleanora rencontre un jeune saxophoniste, Kenneth Hollon, et décroche avec lui ses premiers engagements, dans le Queens et à Brooklyn. Elle a quinze ans et se choisit un nom de scène. Pas n'importe lequel. Lorsque, petite fille, son père passait la voir, il riait de ce garçon manqué et la surnommait Bill. Elle reprend ce sobriquet qu'elle adosse au nom de son père, qu'elle parvient d'ailleurs à retrouver à l'époque, alors qu'il joue dans l'orchestre de Fletcher Henderson. Billie Holiday est née.
La petite Eleanora n'a pas la vie aussi facile : elle endure les violences de sa tante Ida, et subit un premier traumatisme : un jour, alors qu'elle fait la sieste dans les bras de son arrière grand-mère, celle-ci meurt dans son sommeil. Eleanora se réveille étranglée par les bras de la morte et panique. Elle restera plongée dans un mutisme coupable pendant des semaines.
Sadie reprend Eleanora à sa charge après quelques années. Elle a dix ans lorsque, pendant l'une des nombreuses nuits que sa mère passe dehors, elle est violée par un voisin. Elle est par la suite confiée au couvent du Bon Pasteur, où les maltraitances et les humiliations sont monnaie courante. Sadie parvient à en faire sortir sa fille et la reprend avec elle, à New York où elles vivent désormais. En 1928, Sadie se prostitue et installe Eleanora dans un bordel. La vie de la jeune fille est faite d'hommes, de violences, d'un détour en prison. En plein Harlem, sous la prohibition, Eleanora découvre les boîtes clandestines, où l'alcool coule à flots et où le jazz résonne du soir au matin. Presque par hasard, Eleanora rencontre un jeune saxophoniste, Kenneth Hollon, et décroche avec lui ses premiers engagements, dans le Queens et à Brooklyn. Elle a quinze ans et se choisit un nom de scène. Pas n'importe lequel. Lorsque, petite fille, son père passait la voir, il riait de ce garçon manqué et la surnommait Bill. Elle reprend ce sobriquet qu'elle adosse au nom de son père, qu'elle parvient d'ailleurs à retrouver à l'époque, alors qu'il joue dans l'orchestre de Fletcher Henderson. Billie Holiday est née.
Billie Holiday vers 1917
Some Other Spring
Papa et maman étaient mômes à leur mariage : lui dix-huit ans, elle seize ; moi, j’en avais trois.
Maman travaillait comme bonne chez les Blancs. Quand ils se sont aperçus qu’elle était enceinte, ils l’ont foutue à la porte. Les parents de papa, eux, ont failli avoir une attaque en l’apprenant. C’était des gens comme il faut qui n’avaient entendu parler de choses pareilles dans leur quartier à Baltimore.
Mais les deux mômes étaient pauvres, et quand on est pauvre, on pousse vite.
C’est un miracle que Sadie Fagan, ma mère, ne se soit pas retrouvée en maison de redressement et moi à l’Assistance publique. Elle m’a aimée dès l’instant où elle a senti dans son ventre un léger coup de pied, alors qu’elle frottait par terre. Elle est allée à l’hôpital et a proposé un marché à la directrice : pour payer son séjour et le mien, elle ferait le ménage et servirait les autres femelles qui attendaient de faire leurs gosses. Marché conclu : maman avait treize ans ce mercredi 7 avril 1915 quand je suis née à Baltimore.
Le temps de tout rembourser pour sortir de l’hôpital et m’emmener chez ses parents, j’étais assez costaud et éveillée pour me tenir assise dans ma poussette.
Papa avait les activités des garçons de son âge : vendre des journaux, faire des commissions, aller à l’école. Un jour, il s’approcha de ma poussette, me tira de là et se mit à jouer avec moi. Voyant cela, sa mère poussa les hauts cris en le retenant :
Clarence, cesse de jouer avec ce bébé. Tout le monde va croire que c’est le tien.
Et lui de répliquer :
Mais, maman, c’est le mien !
Quand il lui répondait comme ça, elle était au bord de l’apoplexie. Il n’avait que quinze ans, était encore en culottes courtes, voulait devenir musicien et prenait des leçons de trompette. Trois ans après, il a eu droit aux pantalons longs pour le mariage. Après ça, nous sommes allés habiter dans une vieille maisonnette de Durham Steet à Baltimore. Maman avait été bonne dans le Nord, à New York et Philadelphie. Tous les gens riches qu’elle avait vus avaient le gaz et l’électricité ; elle a décidé de les avoir aussi. Alors, elle a économisé ses gages de la journée, et quand nous avons emménagé, nous étions la première famille du quartier à avoir le gaz et l’électricité.
Ça rendait les voisins fous, que maman fasse installer le gaz : d’après eux, si on creusait pour les canalisations, ça ferait sortir les rats. Ils n’avaient pas tort. Baltimore est célèbre pour ses rats.
Papa a toujours voulu jouer de la trompette, mais il n’a jamais eu cette chance. Avant qu’il ait pu s’en procurer une, l’Armée l’a enrôlé et envoyé de l’autre côté de l’océan. Manque de bol, il faisait partie de ceux qui ont été gazés là-bas : les poumons démolis. Il faut croire que s’il avait joué du piano, il aurait reçu une balle dans la main.
Ce fut la fin de ses espérances, mais le début d’une brillante carrière de guitariste. IL a commencé à apprendre à Paris. Une bonne chose pour lui, parce que ça lui a évité la déprime de retour à Baltimore. Il fallait absolument qu’il soit musicien. Il a travaillé d’arrache-pied et obtenu un engagement chez les McKinney’s Cotton Pickers. Mais quand il a commencé à tourner avec cet orchestre, ç’a été le début de la fin de notre vie de famille. Baltimore n’était plus qu’une étape pour lui.
Pendant toute la durée de la guerre, maman avait travaillé dans un atelier de confection d’uniformes et de treillis pour l’Armée. Maintenant, c’était fini et elle a pensé qu’elle gagnerait plus en allant se placer dans le Nord. Alors elle m’a laissée chez mes grands-parents qui habitaient une vieille baraque avec ma cousine Ida, ses deux enfants Henry et Elsie, et mon arrière-grand-mère. […]
Une famille d'esclave dans le Sud des États-Unis ; seconde moitié du XIXe siècle.
Vivien Leigh et Hattie McDaniel dans "Autant en emporte le vent" (1939)
[…]
Un jour, en rentrant de l’école (maman était chez le coiffeur], je n’ai trouvé personne à la maison sauf M. Dick, un de nos voisins. Il m’a raconté que ma mère lui avait demandé de m’attendre et de m’emmener à quelques pas de là chez quelqu’un où elle viendrait nous rejoindre. J’étais sans méfiance, il m’a prise par la main et je l’ai suivi jusqu’à une maison ; là, une femme nous a fait entrer. J’ai réclamé ma mère et ils m’ont répondu qu’elle n’allait pas tarder.
Je crois même qu’ils ont ajouté qu’elle avait téléphoné pour dire qu’elle serait en retard. Il se faisait de plus en plus tard et je commençais à avoir sommeil. M. Dick, voyant que je dormais, m’a emmenée me coucher dans une des chambres du fond. J’étais presque endormie quand il m’a grimpé dessus en essayant de me faire comme mon cousin Henry. Je me suis mise à gigoter et à gueuler comme une perdue. Pendant ce temps, la femme est entrée et a voulu me maintenir la tête et les bras pour qu’il puisse me baiser. Je leur ai fait passer un mauvais quart d’heure, à gigoter, griffer et gueuler. Comme je reprenais mon souffle, j’ai entendu des cris de plus en plus fort. Tout de suite après, ma mère et un policier ont enfoncé la porte.
Je n’oublierai jamais cette nuit-là.
Même si vous êtes une traînée, vous ne voulez pas qu’on vous viole. Même une pute qui ferait vingt-cinq mille passes par jour ne voudrait pas se laisser violer. C’est la pire chose qui puisse arriver à une femme. Et ça m’est arrivé quand j’avais dix ans.
[…]
Ce n’était pas tout. Les flics ont emmené Dick au commissariat, mais ils nous ont emmenées nous aussi, alors que je pleurais dans les bras de ma mère et que je saignais. Au poste, au lieu de nous traiter comme des gens qui ont fait appel à la police, ils ont fait comme si j’étais une criminelle. Ils ont empêché ma mère de me ramener à la maison. M. Dick avait dans les quarante ans, moi dix. Peut-être que l’officier de police avait déduit mon âge de mes seins et de mes jambes, je ne sais pas. En tous cas, ils se sont figurés que c’était moi qui avais attiré ce vieux bouc dans le bordel, ou quelque chose comme ça. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’ils m’ont foutue en taule. Ma mère a eu beau pleurer, supplier, ils l’ont mise à la porte, et m’ont confiée à une grosse matrone blanche. Quand elle a vu que je saignais toujours, elle a eu pitié de moi et m’a donné deux verres de lait. Mais personne d’autre n’a fait quoi que ce soit pour moi, sinon me jeter des coups d’œil graveleux et rire sournoisement.
Au bout de deux jours de cellule, on m’a fait comparaître : M. Dick en a pris pour cinq ans. Pour moi ça été l’institution religieuse. Je n’oublierai jamais cet endroit : il est tenu par des sœurs catholiques, de celles qui restent enfermées entre quatre murs. Quand vous entrez, on vous donne un uniforme bleu et blanc et un nom de sainte. J’ai tiré sainte Thérèse. […]
Billie Holiday – Lady Sings the Blues, 1956
(À suivre ...)







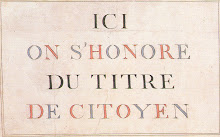







1 commentaire:
On est parfois obligé de s'inventer une vie, ou de la romancer, pour la rendre supportable.
(Elle fait du bien cette musique, l'Ogre ...)
Enregistrer un commentaire