Découvrez Oum Kalthoum!
Abd el Kader (عبد القادر الجزائري ,(1883-1808
Depuis quelque temps, une idée singulière venait le hanter et quoique la sachant bien enfantine, bien irréalisable, il s'y abandonnait, y trouvant une jouissance étrange... Tout quitter, à jamais, renoncer à sa famille, à la France, rester pour toujours en Afrique avec Yasmina... Même démissionner et s'en aller, avec elle toujours, sous le burnous et le turban, mener une existence insoucieuse et lente, dans quelque ksar du Sud... Quand Jacques était loin de Yasmina, il retrouvait toute sa lucidité et il souriait de ces enfantillages mélancoliques... Mais dès qu'il se retrouvait auprès d'elle, il se laissait aller à une sorte d'assouplissement intellectuel d'une douceur indicible. Il la prenait dans ses bras, et, plongeant son regard dans l'ombre du sien, il lui répétait à l'infini ce mot de tendresse arabe, si doux :
- Aziza ! Aziza ! Aziza !
Yasmina ne se demandait jamais quelle serait l'issue de ses amours avec Jacques. Elle savait que beaucoup d'entre les filles de sa race avaient des amants, qu'elles se cachaient soigneusement de leurs familles, mais que, généralement, cela finissait par un mariage.
Elle vivait. Elle était heureuse simplement, sans réflexion et sans autre désir que celui de voir son bonheur durer éternellement.
Quand à Jacques, il voyait bien clairement que leur amour ne pouvait que durer ainsi, indéfiniment, car il concevait l'impossibilité d'un mariage entre lui qui avait une famille, là-bas, au pays, et cette petite Bédouine qu'il ne pouvait même pas songer à transporter dans un autre milieu, sur un sol lointain et étranger.
Elle lui avait bien dit que l'on devait la marier à un cahouadji de la ville, vers la fin de l'automne.
Mais c'était si loin, cette fin d'automne... Et lui aussi, Jacques s'abandonnait à la félicité de l'heure...
- Quand ils voudront me donner au borgne, tu me prendras et tu me cacheras quelque part dans la montagne, loin de la ville, pour qu'ils ne me retrouvent plus jamais. Moi, j'aimerais habiter la montagne, où il y a de grands arbres qui sont plus vieux que les plus anciens des vieillards, et où il y a de l'eau fraîche et pure qui coule à l'ombre... Et puis, il y a des oiseaux qui ont des plumes rouges, vertes et jaunes, et qui chantent...
«Je voudrais les entendre, et dormir à l'ombre, et boire de l'eau fraîche... Tu me cacheras dans la montagne et tu viendras me voir tous les jours... J'apprendrai à chanter comme les oiseaux et je chanterai pour toi. Après, je leur apprendrai ton nom pour qu'ils me le redisent quand tu seras absent».
Yasmina lui parlait ainsi parfois, avec son étrange regard sérieux et ardent...
- Mais, disait-elle, les oiseaux de Djebel Touggour sont des oiseaux musulmans... Ils ne sauront pas chanter ton nom de roumi... Ils ne sauront te dire qu'un nom musulman... et c'est moi qui dois te le donner, pour le leur apprendre... Tu t'appelleras Mabrouk, cela nous portera bonheur.
... Pour Jacques, cette langue arabe était devenue une musique suave, parce que c'était sa langue à elle, et que tout ce qui était elle l'enivrait. Jacques ne pensait plus, il vivait.
Et il était heureux.
Un jour, Jacques apprit qu'il était désigné pour un poste du Sud oranais.
Il lut et relut l'ordre implacable, sans autre sens pour lui que celui-ci, partir, quitter Yasmina, la laisser marier à ce cafetier borgne et ne plus jamais la revoir...
Pendant des jours et des jours, désespérément, il chercha un moyen quelconque de ne pas partir, une permutation avec un camarade... mais en vain.
Jusqu'au dernier moment, tant qu'il avait pu conserver la plus faible lueur d'espérance, il avait caché à Yasmina le malheur qui allait les frapper...
Pendant ses nuits d'insomnie et de fièvre, il en était arrivé à prendre des résolutions extrêmes : tantôt il se décidait à risquer le scandale retentissant d'un enlèvement et d'un mariage, tantôt il songeait à donner sa démission, à tout abandonner pour sa Yasmina, à devenir en réalité ce Mabrouk qu'elle rêvait de faire de lui... Mais toujours une pensée venait l'arrêter ; il y avait là-bas, dans les Ardennes, un vieux père et une mère aux cheveux blancs qui mourraient certainement de chagrin si leur fils, «le beau lieutenant Jacques», comme on l'appelait au pays, faisait toutes ces choses qui passaient par son cerveau embrasé, aux heures lentes des nuits mauvaises.
Yasmina avait bien remarqué la tristesse et l'inquiétude croissante de son Mabrouk et, n'osant encore lui avouer la vérité, il lui disait que sa vieille mère était bien malade, là-bas, fil Fransa...
Et Yasmina essayait de le consoler, de lui inculquer son tranquille fatalisme.
- Mektoub, disait-elle. Nous sommes tous sous la main de Dieu et tous nous mourrons, pour retourner à Lui... Ne pleure pas ; Ya Mabrouk, c'est écrit.
«Oui, songeait-il amèrement, nous devons tous, un jour ou l'autre, être à jamais séparés de tout ce qui nous est cher... Pourquoi donc le sort, ce mektoub dont elle me parle, nous sépare-t-il donc prématurément, tant que nous sommes en vie tous deux ?»
Enfin, peu de jours avant celui fixé irrévocablement pour son départ, Jacques partit pour Timgad... Il allait, plein de crainte et d'angoisse, dire la vérité à Yasmina. Cependant, il ne voulait point lui dire que leur séparation serait probablement, certainement même, éternelle...
Il lui parla simplement d'une mission devant durer trois ou quatre mois.
Jacques s'attendait à une explosion de désespoir déchirant...
Mais, debout devant lui, elle ne broncha pas. Elle continua de le regarder bien en face, comme si elle eût voulu lire dans ses pensées les plus secrètes... et ce regard lourd, sans expression compréhensible pour lui, le troubla infiniment... Mon Dieu ! allait-elle donc croire qu'il l'abandonnait volontairement ?
Comment lui expliquer la vérité, comment lui faire comprendre qu'il n'était pas le maître de sa destinée ? Pour elle, un officier français était un être presque tout-puissant, absolument libre de faire tout ce qu'il voulait.
... Et Yasmina continuait de regarder Jacques bien en face, les yeux dans les yeux. Elle gardait le silence...
Il ne put supporter plus longtemps ce regard qui semblait le condamner.
Il la saisit dans ses bras :
- O Aziza ! Aziza ! dit-il. Tu te fâches contre moi ! Ne vois-tu donc pas que mon cœur se brise, que je ne m'en irais jamais, si seulement je pouvais rester !
Elle fronça ses fins sourcils noirs.
- Tu mens ! dit-elle. Tu mens ! Tu n'aimes plus Yasmina, ta maîtresse, ta femme, ta servante, celle à qui tu as pris sa virginité. C'est bien toi qui tiens à t'en aller !... Et tu mens encore quand tu me dis que tu reviendras bientôt... Non, tu ne reviendras jamais, jamais, jamais !
Et ce mot, obstinément répété sur un ton presque solennel, sembla à Jacques le glas funèbre de sa jeunesse.
Abadane ! Abadane ! Il y avait, dans le son même de ce mot, quelque chose de définitif, d'inexorable et de fatal.
- Oui, tu t'en vas... Tu vas te marier avec une roumia, là-bas, en France...
Et une flamme sombre s'alluma dans les grands yeux roux de la nomade. Elle s'était dégagée presque brusquement de l'étreinte de Jacques, et elle cracha à terre, avec dédain, en un mouvement d'indignation sauvage.
- Chiens et fils de chiens, tous les roumis !
- Oh ! Yasmina, comme tu es injuste envers moi ! Je te jure que j'ai supplié tous mes camarades l'un après l'autre de partir au lieu de moi... et ils n'ont pas voulu.
- Ah ! tu vois bien toi-même que, quand un officier ne veut pas partir, il ne part pas !
- Mais mes camarades, c'est moi qui les ai priés de partir à ma place, et ils ne dépendent pas de moi... tandis que moi je dépends du général, du ministre de la Guerre...
Mais Yasmina, incrédule, demeurait hostile et fermée.
Et Jacques regrettait que l'explosion du désespoir qu'il avait tant redoutée en route n'eût pas eu lieu.
Ils restèrent longtemps ainsi, silencieux, séparés déjà par tout un abîme, par toutes ces choses européennes qui dominaient tyranniquement sa vie à lui et qu'elle, Yasmina, ne comprendrait jamais...
Enfin, le cœur débordant d'amertume, Jacques pleura, la tête abandonnée sur les genoux de Yasmina.
Quand elle le vit sangloter si désespérément, elle comprit qu'il était sincère... Elle serra la chère tête aimée contre sa poitrine, pleurant elle aussi, enfin.
- Mabrouk ! Prunelle de mes yeux ! Ma lumière ! O petite tache noire de mon cœur ! Ne pleure pas, mon seigneur ! Ne t'en va pas, Ya Sidi. Si tu veux partir, je me coucherai en travers de ton chemin et je mourrai. Et alors, tu devras passer sur le cadavre de ta Yasmina. Ou bien, si tu dois absolument partir, emmène-moi avec toi. Je serai ton esclave. Je soignerai ta maison et ton cheval... Si tu es malade, je te donnerai le sang de mes veines pour te guérir... ou je mourrai pour toi. Ya Mabrouk ! Ya Sidi emmène-moi avec toi...
Et comme il gardait le silence, brisé devant l'impossibilité de ce qu'elle demandait, elle reprit :
- Alors, viens, mets des vêtements arabes. Sauvons-nous ensemble dans la montagne, ou bien, plus loin, dans le désert, au pays des Chaâmba et des Touareg... Tu deviendras tout à fait musulman, et tu oublieras la France...
- Je ne puis pas... Ne me demande pas l'impossible. J'ai de vieux parents là-bas, en France, et ils mourront de chagrin... Oh ! Dieu seul sait combien je voudrais pouvoir te garder auprès de moi, toujours.
Il sentait les lèvres chaudes de Yasmina lui caresser doucement les mains, dans le débordement de leurs larmes mêlées... Ce contact réveilla en lui d'autres pensées, et ils eurent encore un instant de joie si profonde, si absolue qu'ils n'en avaient jamais connue de semblable même aux jours de leur tranquille bonheur.
- Oh ! comment nous quitter ! bégayait Yasmina, dont les larmes continuaient à couler.
Deux fois encore, Jacques revint et ils retrouvèrent cette indicible extase qui semblait devoir les lier l'un à l'autre, indissolublement et à jamais.
Mais enfin, l'heure solennelle des adieux sonna... de ces adieux que l'un savait et que l'autre pressentait éternels...
Dans leur dernier baiser, ils mirent toute leur âme...
Cliché, Pierre Bourdieu : Le labour des figuiers en Kabylie, 1959
Longtemps, Yasmina écouta retentir au loin le galop cadencé du cheval de Jacques... Quand elle ne l'entendit plus, et que la plaine fut retombée au lourd silence accoutumé, la petite Bédouine se jeta la face contre terre et pleura...
Un mois s'étant écoulé depuis le départ de Jacques, Yasmina vivait en une sorte de torpeur morne.
Toute la journée, seule désormais dans son oued sauvage, elle demeurait couchée à terre, immobile.
En elle, aucune révolte contre Mektoub auquel, dès sa plus tendre enfance, elle était habituée à attribuer tout ce qui lui arrivait, en bien comme en mal... Simplement une douleur infinie, une souffrance continue, sans trêve ni repos, la souffrance cruelle et injuste des êtres insconscients, enfants ou animaux, qui n'ont même pas l'amère consolation de comprendre pourquoi et comment ils souffrent...
Comme tous les nomades, mélange confus où le sang asiatique s'est perdu au milieu des tribus autochtones, Chaouïya, Berbères, etc., Yasmina n'avait de l'islam qu'une idée très vague. Elle savait - sans toutefois se rendre compte de ce que cela signifiait - qu'il y a un Dieu, seul, unique, éternel, qui a tout créé et qui est Rab-el-Alémine - Souverain des Univers -, que Mohammed est son Prophète et que le Coran est l'expression écrite de la religion. Elle savait aussi réciter les deux ou trois courtes sourates du Coran qu'aucun musulman n'ignore.
Yasmina ne connaissait d'autres Français que ceux qui gardaient les ruines et travaillaient aux fouilles, et elle savait bien tout ce que sa tribu avait eu à en souffrir. De là, elle concluait que tous les roumis étaient les ennemis irréconciliables des Arabes. Jacques avait fait tout son possible pour lui expliquer qu'il y a des Français qui ne haïssent point les musulmans... Mais en lui-même, il savait bien qu'il suffit de quelques fonctionnaires ignorants et brutaux pour rendre la France haïssable aux yeux de pauvres villageois illettrés et obscurs.
Yasmina entendait tous les Arabes des environs se plaindre d'avoir à payer des impôts écrasants, d'être terrorisés par l'administration militaire, d'être spoliés de leurs biens... Et elle en concluait que probablement ces Français bons et humains dont lui parlait Jacques ne venaient pas dans son pays, qu'ils restaient quelque part au loin.
Tout cela, dans sa pauvre intelligence inculte, dont les forces vives dormaient profondément, était très vague et ne la préoccupait d'ailleurs nullement.
Elle n'avait commencé à penser, très vaguement, que du jour où elle avait aimé.
Jadis, quand Jacques la quittait pour rentrer à Batna, elle restait songeuse. Qu'y faisait-il ? Où vivait-il ? Voyait-il d'autres femmes, des roumia qui sortent sans voile et qui ont des robes de soie et des chapeaux comme celles qui venaient visiter les ruines ? Et une vague jalousie s'allumait alors dans son cœur.
Mais, depuis que Jacques était parti pour l'Oranie lointaine, Yasmina avait beaucoup souffert et son intelligence commençait à s'affirmer.
Parfois, dans sa solitude désolée, elle se mettait à chanter les complaintes qu'il avait aimées, et alors elle pleurait, entrecoupant de sanglots déchirants les couplets mélancoliques, appelant son Mabrouk chéri par les plus doux noms qu'elle avait coutume de lui donner, le suppliant de revenir, comme s'il pouvait l'entendre.
Elle était illettrée, et Jacques ne pouvait lui écrire, car elle n'eût osé montrer à qui que ce soit les lettres de l'officier pour se les faire traduire.
Elle était donc restée sans nouvelles de lui.
Cliché, Pierre Bourdieu, 1959
Un dimanche, tandis qu'elle rêvait tristement, elle vit arriver du côté de Batna un cavalier indigène, monté sur un fougueux cheval gris. Le cavalier, qui portait la tenue des officiers indigènes de spahis, poussa son cheval dans le lit de l'oued. Il semblait chercher quelqu'un. Apercevant la petite fille, il l'interpella :
- N'es-tu point Smina bent Hadj Salem ? - Qui es-tu, et comment me connais-tu ? - Alors, c'est bien toi ! Moi, je suis Chérif ben Aly Chaâmbi, sous-lieutenant de spahis, et ami de Jacques. C'est bien toi qui étais sa maîtresse ?
Épouvantée de voir son secret en possession d'un musulman, Yasmina voulut fuir. Mais l'officier la saisit par le poignet et la retint de force.
- Où vas-tu, fille du péché ? J'ai fait toute cette longue course pour voir ta figure et tu te sauves ?
Elle faisait de vains efforts pour se dégager.
- Lâche-moi ! Lâche-moi ! Je ne connais personne, je n'étais la maîtresse de personne !
Chérif se mit à rire.
- Si, tu étais sa maîtresse, fille du péché ! Et je devrais te couper la tête pour cela, bien que Jacques soit un frère pour moi. Viens là-bas, au fond de l'oued. Personne ne doit nous voir. J'ai une lettre de Jacques pour toi et je vais te la lire.
Joyeusement, elle battit des mains.
Jacques lui faisait savoir qu'elle pouvait avoir toute confiance en Chérif et que, s'il lui arrivait jamais malheur, elle devrait s'adresser à lui. Il lui disait qu'il ne pensait qu'à elle, qu'il lui était toujours resté fidèle. Il terminait en lui jurant de toujours l'aimer, de ne jamais l'oublier et de revenir un jour la reprendre.
... Beaux serments, jeunes résolutions irrévocables, et que le temps efface et anéantit bien vite, comme tout le reste !...
Yasmina pria Chérif de répondre à Jacques qu'elle aussi l'aimait toujours, qu'elle lui resterait fidèle tant qu'elle vivrait, qu'elle restait son esclave soumise et aimante, et qu'elle aimerait être le sol sous ses pieds.
Chérif sourit.
- Si tu avais aimé un musulman, dit-il, il t'aurait épousée selon la loi, et tu ne serais pas ici à pleurer...
- Mektoub !
Et l'officier remonta sur son étalon gris et repartit au galop, soulevant un nuage de poussière.
Jacques craignait d'attirer l'attention des gens du douar et il différa longtemps l'envoi de sa seconde lettre à Yasmina... Si longtemps que quand il voulut lui écrire, il apprit que Chérif était parti pour un poste du Sahara.
Cliché, Pierre Bourdieu : Djebabra, Chélif, 1959
Isabelle Eberhardt (1877-1904) ; Yasmina, 1902
(À suivre...)






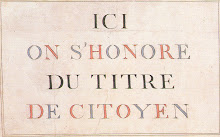







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire