
Le jour se lève. C'est
dans le golfe d'Aden - une région éternellement chaude et une
région de mirages.
Devant nous (qui revenons
de l'Inde sous un inaltérable ciel bleu) l'horizon est comme fermé
maintenant par des voiles lourds, d'un gris violacé et presque noir.
Pour des yeux de marins
exercés à connaître de loin les terres, il y a des terres
là-dessous, assurément ; sans les voir, on les devine à je ne sais
quoi d'opaque et d'immobile qu'ont ces nuages. Il y a même plus que
des îles évidemment ; on aurait beau n'en être pas prévenu, on
s'en douterait : ceci, qui ternît le ciel par un tel amoncellement
de vapeurs, doit être massif, puissant, immense ; on sent dans ces
lointains les grands contours, les lignes infinies d'un continent.
Un continent en effet -
et le plus profond, le plus immuable de tous : l'Afrique.
On s'approche ; alors, au
premier plan, se dessine et s'éclaire une espèce de falaise droite,
unie, monotone. Elle est en sable durci et raviné ; au soleil
matinal, elle parait d'une teinte rose, éclatante, sur ces fonds
d'ombre intense. Par derrière, du côté de l'intérieur, le rideau
obscur persiste, s'accentue ; des nuages, des montagnes sont là,
brouillés, confondus dans du sombre profond ; «c'est comme une
sorte de chaos trouble où couveraient tous les orages de la terre.
On suit des yeux la falaise miroitante qui est la première assise de
ce sol ; elle s'en va à perte de vue, toujours la même, triste,
inutile, morte, - et, rien qu'en la regardant fuir, on a conscience
de l'énormité de ce continent des déserts à qui l'espace ne coûte
pas ; on à l'impression de l'immense Afrique, chaude et désolée.
Il y a çà et là
quelques broussailles, que l'on distingue en s'approchant davantage ;
des arbustes ayant forme de petits bouquets ronds, de petits
parasols. La verdure en est pâle, tournée au bleu comme par un
excès de soleil, qui l'aurait fanée, - et on les croirait
transparents, tant leur feuillage est léger et grêle.

Cliché satellite du golfe de Tadjoura (République de Djibouti)
Le pays où nous arrivons
est celui des Dankalis, dépendant du sultan de Tadjoura, et en
redescendant un peu le long de cette côte, nous trouverons
l'établissement français d'Obock.
Il apparaît bientôt,
dans une vapeur lumineuse qu'agite sans cesse un tremblement de
mirage. C'est d'abord une grande construction neuve, à véranda
comme celles d'Aden, visible de loin avec sa blancheur sur ces
sables. Bâtie par la compagnie qui fournit du charbon aux navires de
passage, elle est 1à unique, un peu surprenante, par son air de
confort et de sécurité au milieu de ce pays maudit. Ensuite un
enclos à murailles de terre séchée, avec, au milieu, les débris
cornus d'une tour ; on dirait déjà d'une ruine très ancienne, de
quelque vieille mosquée détruite, - et cela ne compte pas trois ans
d'existence ! C'était la .première habitation du .résident
français, construite en manière de donjon arabe, qui, une belle
nuit de l'an dernier, s'est éboulée pendant une inondation
descendue tout à coup des montagnes d'Abyssinie.
Un petit village, un
hameau africain vient après ; il est du même gris roux que la terre
et le sable, il a été calciné par le même soleil. Ses huttes en
paillassons, toutes basses, ressemblent à des nids de bêtes. De
loin, on voit remuer là, comme d'étranges poupées, quatre ou cinq
personnages en costumes éclatant, robes de couleur rouge, orange ou
blanche d'où s'échappent de longs bras noirs, et puis d'autres tout
nus, qui ont des silhouettes de singe.
Et enfin là-bas ; sur
une espèce de cap, des maisonnettes bien neuves, avec toitures de
tuiles rouges ; dix ou douze en tout, symétriquement rangées, ayant
un air d'usine ou de cité ouvrière. C'est l'Obock officiel, l'Obock
du gouverneur et de la garnison, qui détonne bien piètrement sur la
désolation grandiose d'alentour.

Nous mouillons en eau
très calme, dans ce qu'on appelle le Port d'Obock. C'est bien un
port en effet, un abri assez sûr contre les houles du large ; mais
on ne le dirait pas à première vue, car la ceinture de corail qui
le protège est à fleur d'eau, traçant à peine un cerne verdâtre
sur tout le bleu immobile de la mer.
Nous sommes en l'un des
points les plus chauds du monde. Il est huit heures du matin à
peine, et on éprouve déjà aux joues, aux tempes, une sensation
cuisante comme si on était près d'un grand feu, - et il y a sur la
mer, sur les sables rapprochés qui éblouissent, une terrible
réverbération de soleil. Mais c'est une chaleur sèche, presque
saine si on la compare à ces humidités de chaudière que nous avons
laissées derrière nous en Cochinchine et en Annam ; les vents qui
soufflent ici, d'où qu'ils viennent, ont passé sur les grands
déserts sans eau de l'Afrique ou de l'Arabie ; on sent que cet air
est pur et, si l'on peut dire, vivifiant.

Groupe de guerriers Danakil (région d'Obock)
Cliché de la mission Maurice Maindron (1857-1911) ; 1893 [?]
Cliché de la mission Maurice Maindron (1857-1911) ; 1893 [?]
Un court trajet en canot,
sur une eau tiède - au-dessus d'un vrai jardin dé madrépores, - et
nous mettons pied à terre, sur un sol rosé qui brûle ; puis, par
un sentier de sable, nous voici sur une sorte d'esplanade dominant la
mer, au milieu des maisonnettes à toits rouges, dans l'Obock des
Européens.
L'habitation du
gouverneur est au centre ; on y monte par un perron en boue séchée,
en mortier grisâtre, qui a une intention d'être monumental, de
représenter, pour les réceptions des chefs noirs. En haut de ces
marches, le logis, qui n'a pour murailles que des barreaux à jour,
se dresse avec une prestance de cage à poule ; tous les vents
peuvent passer au travers. Il y a en face quatre petits canons - une
batterie pour rire - et un pavillon français qui flotte au bout d'un
mat. Les autres cases, pareillement construites à claire-voie, sont
rangées avec symétrie de chaque côté de cette imposante demeure
et servent à abriter les soixante ou quatre-vingts hommes
d'artillerie et d’infanterie de marine qui composent la garnison
d'Obock.
Une palissade enfantine
est la défense de ce quartier des blancs ; on l'a faite avec de ces
arbustes en forme de parasol (les seuls qui croissent dans ce pays)
couchés tels quels à côté les uns des autres par terre, comme une
rangée de larges bouquets épineux.
Dans cet enclos circulent
des soldats alertes, empressés, qui s'occupent pour l'instant de
préparer leur repas du matin. Ici ce ne sont plus les figures tirées
et pâlies que nous avions coutume de voir en Cochinchine et au
Tonkin. Ces hommes ont bonne mine ; coiffés tous d'un casque blanc,
à peine vêtus d'une brassière sans manches, ils gardent un air de
santé sous leur hâle de soleil ; leurs bras nus ont bruni comme
ceux des Bédouins.
Ils font leur cuisine,
épluchent de vraies salades, de vrais légumes - qui étonnent dans
ce pays d'aridité absolue. Ils ont réussi à faire un jardin,
parait-il, qu'ils arrosent et où tout cela pousse.
Des négrillons gambadent
au milieu d'eux familièrement, des petits êtres croisés d'Arabes
ou d'Indiens, qui ont des yeux allongés, des lèvres fines et de
jolis profils. Cet Obock a presque un air de vie.
Un ravin de sable sépare
ce quartier militaire du village africain - qui nous paraît trés
augmenté depuis une année. Et pourtant, d'où viennent-ils, ces
gens ? Par quels chemins, à travers quelles solitudes ont-ils passé
pour se réunir ici, quand il n'y a si loin alentour que
d'inhabitables déserts ?
Il est certain qu'un
centre minuscule de transactions cherche à se former à Obock. C'est
presque une petite rue à présent, qui s'ouvre et se prolonge devant
nous, tout inondée de lumière, toute dévorée de soleil, entre
deux rangées d'une vingtaine de cases ou de tentes. Il y a même, à
l'entrée, une maisonnette avec de vrais murs, construite à la
mauresque, et un débit d'absinthe qu'un colon européen (l'unique du
pays) a déjà ouvert à l'usage de nos soldats. Le reste n'est
encore composé que de ces huttes indigènes si basses qu'on en
touche le dessus avec la main ;. elles sont soutenues par des
morceaux de bois noueux qui ressemblent à de vieux ossements, à de
vieilles jambes torses (toujours les branches de ces mêmes arbustes
qui ont fourni la palissade du gouverneur) et recouvertes de
paillassons, cousus les uns aux autres comme des loques rapiécées.
Le sol est piétiné, battu, mêlé de détritus qui pourrissent et
se dessèchent. Il y a en l'air des légions de mouches.
À notre rencontre
arrivent deux jeunes femmes noires, aux lèvres minces, souriant d'un
sourire faux et méchant - des « madames dankalies »,
nous dit, en manière de présentation, un petit nègre qui passe. -
C'est pour nous vendre la pelure fraîchement écorchée d'une
panthère, que l'une d'elles porte sur l'épaule. Elles ont de
singulières têtes, ces « madames dankalies », et nous font
des mines de moquerie sauvage, avec leurs yeux vifs qui roulent. Au
soleil, on voit leur peau luire comme de l'ébène frotté d'huile.

Jeunes filles et enfant Danakil (région d'Obock)
Cliché de la mission Maurice Maindron (1857-1911) ; 1893 [?]
Cliché de la mission Maurice Maindron (1857-1911) ; 1893 [?]
Le long de cette rue, ce
ne sont que petits cafés, petites échoppes. Sous chacun de ces
paillassons, quelque chose se boit ou se trafique. Et le tout a un
air d'improvisé, de caravansérail, de marché africain qui
commence.
Cafés à l'arabe, où
l'on boit dans de très petites tasses apportées d'Aden, en fumant
dans de très grands narguilés de cuivre d'une forme monumentale ; -
où l'on consomme des pastèques roses et des cannes à sucre.
Boutiques en extrême
miniature, où tout le fonds et l’étalage tiennent sur une table à
casiers : un peu de riz dans un compartiment, un peu de, sel dans un
autre ; un peu de cannelle, un peu de safranum, un peu de gingembre ;
puis des petits tas de graines bizarres, de racines inconnues. Et le
même marchand vend aussi des turbans en coton, des costumes à la
mode d’Égypte et des pagnes d'Éthiopie.
Acheteurs et vendeurs
(deux cents personnes au plus) appartiennent à toute sorte de races.
Nègres très noirs, frisés et luisants, au torse nu, à l'attitude
superbe. Arabes à grands yeux peints, vêtus de blanc, de vert clair
ou de jaune d'or. Hommes fauves, longs et minces, à cou de cigogne,
à profil de chèvre, ayant de longues chevelures teintes en blanc
roux qui tranchent sur leurs épaules comme une toison de mouton
mérinos sur du bronze. Dankalis portant des colliers de coquillages.
Et deux ou trois Malabars égarés, jetant dans ce mélange un
souvenir de l'Inde voisine.
Au fond de ces petites
niches en paille qui sont des cafés, ces hommes s'asseyent pèle-mêle
pour jouer et pour boire. Les uns s'amusent aux dés. D'autres ont
choisi un jeu plus simple, du désert, qui consiste à tracer par
terre sur le sable des combinaisons de lignes. Deux nègres tout nus,
ornés de gris-gris, font avec feu une partie de piquet, en frappant
très fort leurs atouts sur la table ; ils ont de vraies cartes, qui
étonnent entre leurs mains sauvages.
À côté d'eux, trois
autres se livrent à. un aussi surprenant domino. Ils appartiennent,
ceux-ci, à l'espèce des hommes minces et fauves qui se blanchissent
la chevelure ; la leur est couverte en ce moment de la composition
décolorante qu'ils enlèveront demain pour être beaux : c'est comme
un mortier qui forme croûte épaisse sur leur tête ; on dirait la
chaux dont on enduit les momies.
Au-dessus de ces joueurs,
les paillassons du toit font à peine un peu d'ombre ; le soleil, le
terrible soleil passe au travers comme par les mille trous d'un
crible, - et, autour des petites huttes surchauffées, à perte de
vue, tout flamboie, tout brûle dans l'immense Afrique.
On est vite au bout de ce
village. Alors on arrive à quatre cases, les dernières, un peu
isolées des autres sur une dune : c'est le quartier des dames
galantes. Elles sont là huit ou dix, assez belles, Abyssines,
Somaulies ou Dankalies, attendant sous leur toit de nattes. Vêtues
de longues robes rouges, les chevilles et les poignets ornés de
lourds anneaux d'argent, elles se tiennent au guet, l'air moitié
mystique, moitié féroce ; très dignes dans leur impudeur noire ;
s'acquittant de leur métier comme d'une fonction religieuse - et,
pour une pièce blanche, accueillant avec le même beau sourire de
tigresse le soldat français, le Bédouin qui passe ou le nègre à
gris-gris.

Jeunes filles Danakil (région d'Obock)
Cliché de la mission Maurice Maindron (1857-1911) ; 1893 [?]
Cliché de la mission Maurice Maindron (1857-1911) ; 1893 [?]
Après ce quartier c'est
fini, par exemple ; tout de suite le désert commence, profond,
miroitant, plein de mirages, sinistre avec son soleil qui tue.
Il y a bien encore, par
là, dans un repli du terrain, quelque chose d'un peu vert : le
jardin, le fameux jardin que les soldats entretiennent à force de
soins et d'arrosage. Autrement, plus rien. Nous avons devant nous
cette région vide qui, sur les cartes, porte le nom de plateau des
gazelles.
À l’extrême horizon,
du côté des terres, toujours ce même rideau de nuages et de
montagnes bornant l'étendue désolée où nous sommes. Très hautes
sans doute, ces montagnes qui se dessinent là-bas partout en
silhouettes entassées, d'autant plus confondues avec les obscurités
du ciel, d'autant plus noires qu'elles sont plus loin, dans ces zones
intérieures où les hommes blancs ne vont pas. Et ces fonds qui se
maintiennent aujourd'hui si sombres font ressortir davantage l'éclat
doré des sables, l'éblouissement des premiers plans.
À mesure que nous nous
avançons sur ce « plateau des gazelles », le tout petit
Obock, avec ses tuiles rouges et ses trois maisons, s'abaisse dans le
lointain, s'efface, disparaît ; la plaine lumineuse et morne
s'agrandit uniformément autour de nous.
La mer aussi est hors de
vue ; cependant le sol est toujours semé de rameaux de corail et de
coquilles roulées (pour les naturalistes, des strombes à bouche
rose) ; on dirait d'un fond sous-marin qu'une énorme poussée d'en
bas aurait amené en plein soleil. Il y a, çà et là, quelques
touffes d'herbes roussies, quelques plantes bizarres, d'un vert
extrêmement pâle comme si l'excès de ce soleil en avait mangé la
couleur. Et puis, de distance en distance, posés comme pour faire
jardin anglais, de ces chétifs arbustes en forme d'ombelle, au
feuillage ténu et clair, comme nous en avions déjà vu du large -
espèces de parasols d'épines penchés à droite ou à gauche sur
leur tronc grêle : c'est un mimosa triste, l'éternel mimosa des
solitudes africaines, le même qui croit dans toutes les régions
arides de l’intérieur - jusque là-bas, de l'autre côté des
grands déserts, dans les sables du Sénégal ; un mimosa qui ne
produit rien ; ne sert à rien, ne donne même pas d'ombre...

Groupe de guerriers Afar (région d'Assaita, Éthiopie)
Cliché de Éric Lafforgue
Cliché de Éric Lafforgue
Quels hommes peut nourrir
une terre pareille ? Ceux-ci, évidemment, ces êtres sveltes et
fauves, à l'air félin, au regard sauvage, qu'on nous a désignés
tout à l'heure dans le village d'Obock comme étant les Dankalis
indigènes ; ils sont des personnages cadrant bien avec leur pays ;
ils y vivent errants, clairsemés au milieu des sables ou des
halliers, et l'éternelle chaleur semble avoir desséché, affiné
leur corps comme celui des gazelles.
Nous en croisons
quelques-uns qui arrivent des contrées de l'intérieur ; avec un
léger bagage sur le dos. Et un autre groupe de « mesdames
dankalies » s'arrête à nous comme tout à l'heure, avec les
mêmes faux sourires ouverts sur de belles dents blanches : encore
une pelure de panthère qu'elles déroulent pour nous la vendre.
De loin en loin dans la
plaine, des gens sont campés, tout au ras de la terre brûlante. On
se courbe comme les bêtes pour entrer dans leurs huttes. Ils se
tiennent assis là, ayant avec eux des ânons, des outres en peau,
des gris-gris, des sabres et des couteaux d'une forme méchante ;
immobiles, oisifs, venus dans la direction. d'Obock pour trafiquer ou
peut-être seulement pour voir. Leur accueil est inquiet et
inquiétant ; l'entrevue de part et d'autre est pleine d'étonnements
et de méfiances.

Le commerçant Paul Soleillet (1842-1886) chez lui à Obock
Cliché de L. Bidault, 1884
Cliché de L. Bidault, 1884
Il est maintenant onze
heures du matin. Avec ces mirages, cette réverbération des sables,
tout miroite et tremble ; une clarté aveuglante monte de la terre.
Nous voyons de loin deux
ou trois amas de choses très blanches qui tranchent sur la plaine
rousse. Est-ce un peu de neige tombée là par miracle, ou bien de la
chaux, ou bien des pierres ? Mais non, cela remue. - Alors des hommes
en burnous ? - ou des bêtes ? - des gazelles ? des chevaux ? - Cela
ressemble à tout ce qu'on veut, même à des éléphants blancs, car
on n'a plus la notion complète des distances ni des grandeurs :
toutes les choses un peu lointaines sont déformées et changeantes.
Tout simplement des
moutons. - Des moutons drôles, d'une blancheur extrême avec la tête
bien noire et la queue élargie en éventail, comme ceux d'Égypte.
Rares troupeaux qu'on envoie dans le jour brouter je ne sais quelles
herbes et que l'on se hâte de ramener vers le village d'Obock au
coucher du soleil, avant l'heure des bêtes fauves.
Ce sont les derniers
êtres vivants que nous rencontrons en continuant de nous éloigner
dans l'immense plaine. Bientôt midi. À cette heure, les hommes
blancs ne sortent jamais ; il faut notre imprudence, à nous qui
arrivons et qui voulons voir. Nous sentons sur nos épaules, à
travers nos vêtements de toile blanche, une impression cuisante de
brûlure. En marchant, nous ne projetons plus ombre, à peine un
petit cercle noir qui s'arrête à nos pieds : le soleil est juste en
haut du ciel, au zénith, et tout son feu tombe verticalement sur la
terre.
Nulle part rien ne bouge
; tout est mort de chaleur ; on n'entend même pas ces musiques
d'insectes qui, dans les autres pays du monde, sont les bruits
persistants de la vie durant les midis d'été. Mais toute la plaine,
tremble de plus en plus, tremble, tremble - d'un mouvement qui est
incessant, rapide, fébrile, mais qui est absolument silencieux,
comme celui des objets imaginaires, des visions. Sur tous les
lointains est répandue une indéfinissable chose qui ressemble à
une eau mouvante, ou à une étoile de gaze remuée par le vent, et
qui n'existe pas, qui n'est rien qu'un mirage. Les mimosas éloignés
prennent des formes étranges, s'allongent ou s'étendent, se
dédoublent par le milieu, comme reflétés dans cette eau trompeuse
qui envahit les sables sans faire aucun bruit, qui s'agite sans qu'il
y ait dans l’air aucun souffle. Et tout cela étincelle, éblouit,
fatigue ; l'imagination est inquiétée par le grand resplendissement
triste de ce désert.
Au fond, il y a toujours
ces montagnes sombres sous des amoncellements de nuages lourds. De ce
côté, tout finit en une espèce de désolation indécise,
ténébreuse ; la vue se perd dans des profondeurs noires ; c'est
l'intérieur de l'Afrique qui est derrière ces obscurités et ces
orages...
Pierre Loti
(1850-1923) ; Obock (en passant), in Revue Bleue,
1er sem. 1887, n°9, 26 février.

Groupe de Danakil (région d'Obock)
photog. inconnu (avant 1900)
photog. inconnu (avant 1900)

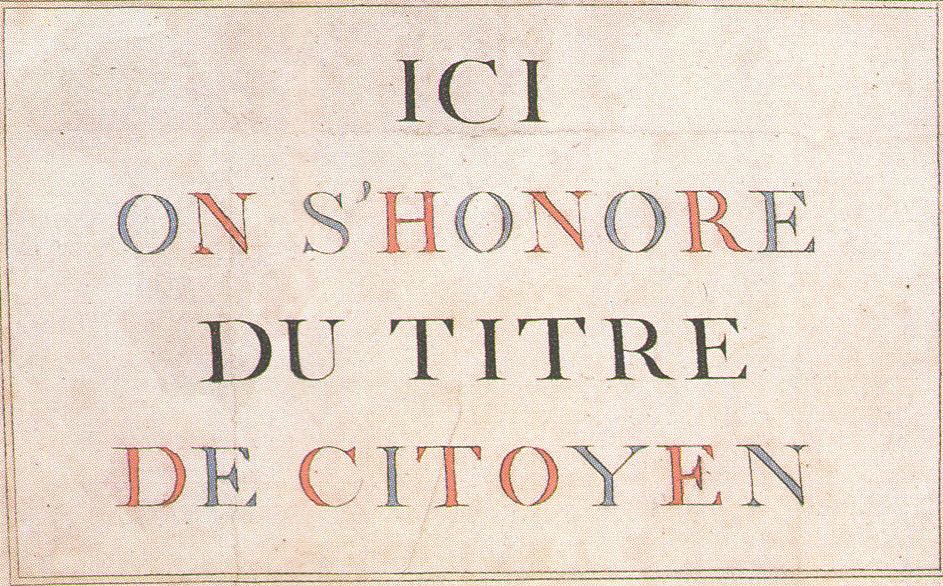







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire