... De ce que de forts esprits vous en disent pourtant depuis des siècles...
Maudits temps modernes, anciens et à venir !!! Voilà ce que j'en dis...
Maudits temps modernes, anciens et à venir !!! Voilà ce que j'en dis...

François Clouet (vers 1520-1572) ;
portrait de Henri II, roy de France
Notre nature est ainsi, que les
communs devoirs de l’amitié l’emportent une bonne partie du
cours de notre vie ; il est raisonnable d’aimer la vertu,
d’estimer les beaux faits, de reconnaître le bien d’où l’on
l’a reçu, et diminuer souvent de notre aise pour augmenter
l’honneur et avantage de celui qu’on aime et qui le mérite.
Ainsi donc, si les habitants d’un pays ont trouvé quelque grand
personnage qui leur ait montré par épreuve une grande prévoyance
pour les garder, une grande hardiesse pour les défendre, un grand
soin pour les gouverner ; si, de là en avant, ils
s’apprivoisent de lui obéir et s’en fier tant que de lui donner
quelques avantages, je ne sais si ce serait sagesse, de tant qu’on
l’ôte de là où il faisait bien, pour l’avancer en lieu où il
pourra mal faire ; mais certes, si ne pourrait-il faillir d’y
avoir de la bonté, de ne craindre point mal de celui duquel on n’a
reçu que bien.

François Clouet (vers 1520-1572) ;
portrait de Catherine de Médicis
portrait de Catherine de Médicis
Mais, ô bon
Dieu ! que peut être cela ? comment dirons-nous que cela
s’appelle ? quel malheur est celui-là ? quel vice, ou
plutôt quel malheureux vice ? Voir un nombre infini de
personnes non pas obéir, mais servir ; non pas être gouvernés,
mais tyrannisés ; n’ayant ni biens ni parents, femmes ni
enfants, ni leur vie même qui soit à eux ! souffrir les
pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d’une armée,
non pas d’un camp barbare contre lequel il faudrait défendre son
sang et sa vie devant, mais d’un seul ; non pas d’un Hercule
ni d’un Samson, mais d’un seul hommeau, et le plus souvent le
plus lâche et femelin de la nation ; non pas accoutumé à la
poudre des batailles, mais encore à grand peine au sable des
tournois ; non pas qui puisse par force commander aux hommes,
mais tout empêché de servir vilement à la moindre femmelette !
Appellerons-nous cela lâcheté ? dirons-nous que ceux qui
servent soient couards et recrus ? Si deux, si trois, si quatre
ne se défendent d’un, cela est étrange, mais toutefois possible ;
bien pourra-l’on dire, à bon droit, que c’est faute de cœur.
Mais si cent, si mille endurent d’un seul, ne dira-l’on pas
qu’ils ne veulent point, non qu’ils n’osent pas se prendre à
lui, et que c’est non couardise, mais plutôt mépris ou dédain ?
Si l’on voit, non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays,
mille villes, un million d’hommes, n’assaillir pas un seul,
duquel le mieux traité de tous en reçoit ce mal d’être serf et
esclave, comment pourrons-nous nommer cela ? est-ce lâcheté ?
Or, il y a en tous vices naturellement quelque borne, outre laquelle
ils ne peuvent passer : deux peuvent craindre un, et possible
dix ; mais mille, mais un million, mais mille villes, si elles
ne se défendent d’un, cela n’est pas couardise, elle ne va point
jusque-là ; non plus que la vaillance ne s’étend pas qu’un
seul échelle une forteresse, qu’il assaille une armée, qu’il
conquête un royaume. Donc quel monstre de vice est ceci qui ne
mérite pas encore le titre de couardise, qui ne trouve point de nom
assez vilain, que la nature désavoue avoir fait et la langue refuse
de nommer ?

François Clouet (vers 1520-1572) ;
portrait de Jean Babou, seigneur de la Bourdaisiè
portrait de Jean Babou, seigneur de la Bourdaisiè
[...] C’est chose étrange d’ouïr parler de la vaillance que la
liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent ; mais ce
qui se fait en tous pays, par tous les hommes, tous les jours, qu’un
homme mâtine cent mille et les prive de leur liberté, qui le
croirait, s’il ne faisait que l’ouïr dire et non le voir ?
Et, s’il ne se faisait qu’en pays étranges et lointaines terres,
et qu’on le dit, qui ne penserait que cela fut plutôt feint et
trouvé que non pas véritable ? Encore ce seul tyran, il n’est
pas besoin de le combattre, il n’est pas besoin de le défaire, il
est de soi-même défait, mais que le pays ne consente à sa
servitude ; il ne faut pas lui ôter rien, mais ne lui donner
rien ; il n’est pas besoin que le pays se mette en peine de
faire rien pour soi, pourvu qu’il ne fasse rien contre soi. Ce sont
donc les peuples mêmes qui se laissent ou plutôt se font
gourmander, puisqu’en cessant de servir ils en seraient quittes ;
c’est le peuple qui s’asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant
le choix ou d’être serf ou d’être libre, quitte la franchise et
prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le pourchasse. S’il
lui coûtait quelque chose à recouvrer sa liberté, je ne l’en
presserais point, combien qu’est-ce que l’homme doit avoir plus
cher que de se remettre en son droit naturel, et, par manière de
dire, de bête revenir homme ; mais encore je ne désire pas en
lui si grande hardiesse ; je lui permets qu’il aime mieux je
ne sais quelle sûreté de vivre misérablement qu’une douteuse
espérance de vivre à son aise. Quoi ? si pour avoir liberté
il ne faut que la désirer, s’il n’est besoin que d’un simple
vouloir, se trouvera-t-il nation au monde qui l’estime encore trop
chère, la pouvant gagner d’un seul souhait, et qui plaigne la
volonté à recouvrer le bien lequel il devrait racheter au prix de
son sang, et lequel perdu, tous les gens d’honneur doivent estimer
la vie déplaisante et la mort salutaire ? Certes, comme le feu
d’une petite étincelle devient grand et toujours se renforce, et
plus il trouve de bois, plus il est prêt d’en brûler, et, sans
qu’on y mette de l’eau pour l’éteindre, seulement en n’y
mettant plus de bois, n’ayant plus que consommer, il se consomme
soi-même et vient sans force aucune et non plus feu :
pareillement les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils
ruinent et détruisent, plus on leur baille, plus on les sert, de
tant plus ils se fortifient et deviennent toujours plus forts et plus
frais pour anéantir et détruire tout ; et si on ne leur baille
rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils
demeurent nus et défaits et ne sont plus rien, sinon que comme la
racine, n’ayant plus d’humeur ou aliment, la branche devient
sèche et morte.

François Clouet (vers 1520-1572) ;
Claude Gouffier , sire de Boisy, duc de Roannais, comte de Maulevrier et seigneur d'Oiron
Claude Gouffier , sire de Boisy, duc de Roannais, comte de Maulevrier et seigneur d'Oiron
[...] Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en
votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez emporter
devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos
champs, voler vos maisons et les dépouiller des meubles anciens et
paternels ! Vous vivez de sorte que vous ne vous pouvez vanter
que rien soit à vous ; et semblerait que meshui ce vous serait
grand heur de tenir à ferme vos biens, vos familles et vos vies ;
et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous vient, non pas des
ennemis, mais certes oui bien de l’ennemi, et de celui que vous
faites si grand qu’il est, pour lequel vous allez si courageusement
à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de
présenter à la mort vos personnes. Celui qui vous maîtrise tant
n’a que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et
n’a autre chose que ce qu’a le moindre homme du grand et infini
nombre de nos villes, sinon que l’avantage que vous lui faites pour
vous détruire. D’où a-t-il pris tant d’yeux, dont il vous épie,
si vous ne les lui baillez ? Comment a-t-il tant de mains pour
vous frapper, s’il ne les prend de vous ? Les pieds dont il
foule vos cités, d’où les a-t-il, s’ils ne sont des vôtres ?
Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous, que par vous ? Comment
vous oserait-il courir sus, s’il n’avait intelligence avec vous ?
Que vous pourrait-il faire, si vous n’étiez receleurs du larron
qui vous pille, complices du meurtrier qui vous tue et traîtres à
vous-mêmes ? Vous semez vos fruits, afin qu’il en fasse le
dégât ; vous meublez et remplissez vos maisons, afin de
fournir à ses pilleries ; vous nourrissez vos filles, afin
qu’il ait de quoi soûler sa luxure ; vous nourrissez vos
enfants, afin que, pour le mieux qu’il leur saurait faire, il les
mène en ses guerres, qu’il les conduise à la boucherie, qu’il
les fasse les ministres de ses convoitises, et les exécuteurs de ses
vengeances ; vous rompez à la peine vos personnes, afin qu’il
se puisse mignarder en ses délices et se vautrer dans les sales et
vilains plaisirs ; vous vous affaiblissez, afin de le rendre
plus fort et roide à vous tenir plus courte la bride ; et de
tant d’indignités, que les bêtes mêmes ou ne les sentiraient
point, ou ne l’endureraient point, vous pouvez vous en délivrer,
si vous l’essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de
le vouloir faire. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà
libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l’ébranliez, mais
seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand
colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en
bas et se rompre.

François Clouet (vers 1520-1572) ;
Jeanne III d'Albret, reine de Navarre
Jeanne III d'Albret, reine de Navarre
Étienne de la Boëtie (1530-1563) - Le Contr'Un ou discours de la servitude volontaire... 1549

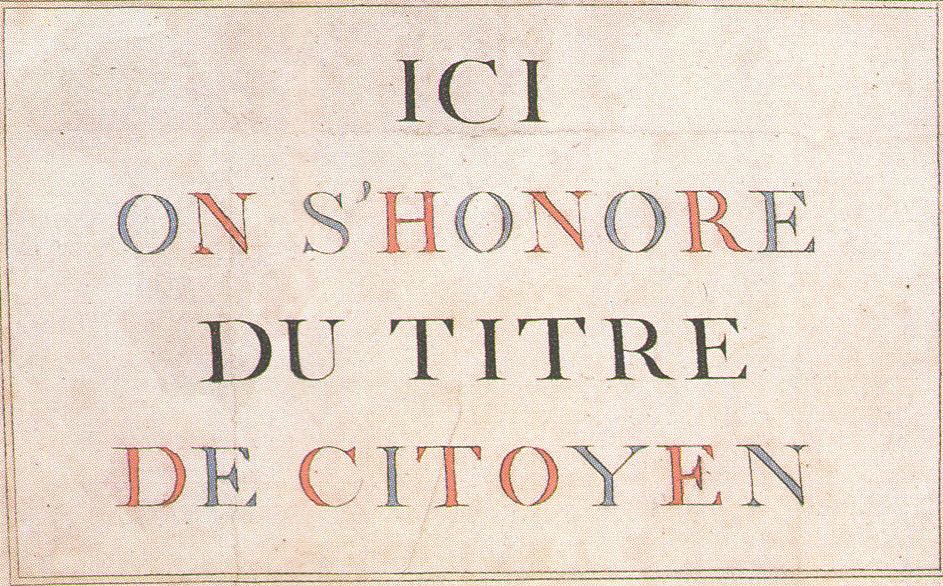







3 commentaires:
... qu'importe, moi je suis soulagée ce soir... et je me sens fière et libre...
Un esclave a qui on laisse le droit de choisir son maître n'est plus vraiment un esclave. La lettre de licenciement envoyée hier fait pendant à toutes celles que les gens reçoivent eux-mêmes. Et que vive la République !
...Permettez-moi juste de conclure en langue rimbaldienne : "...Et libre soit cette infortune"...
Pour le reste, z'avez gagné le "droit" de m'envoyer deuxxx dissertes : l'une sur la notion de Liberté et l'autre sur la notion de république universelle et/ou idéale...
Enfin, si l'une d'entre vous veut bien me démontrer l'avantage qu'il y a à se trouver dans un état de servitude volontaire plutôt qu'en situation d'esclavage subit, sur le plan de la philosophie morale, (et non à propos du poids des chaînes, etc...) et m'indiquer ce que nos sociétés ont de philanthropique, je suis preneur et promet de publier l'article ou l'essai ici même...
Bien à vous, gourmandes et croquantes créatures, d'ici à me régaler de votre prose...
PS. Je crois me souvenir d'une BD de Binet (auteur des "Bidochons", dans la série "Kador" intitulée : Ni Dieu, mais un maître...
Enregistrer un commentaire