
Sir Richard Francis Burton (1821-1890)
Son voyage en Arabie
achevé, Burton passa le mois de novembre 1853 au Caire, où il commença à
rédiger sa monumentale « Relation Personnelle d'un Pèlerinage à Médine et La Mecque »l. Mais le congé d'un an que l'East India
Company lui avait généreusement octroyé touchant à son terme, il dut regagner
bientôt Bombay. En s'embarquant pour l'Inde, il ne put résister au plaisir de
revêtir à nouveau l'ample tunique et le turban du pèlerin (hadji). Sur le navire, il se lia d'amitié avec un
membre du Bombay Council, James Lumsden, qui, après l'avoir pris pour un
authentique musulman, devait l'introduire dans les hautes sphères de la colonie
anglaise - notamment auprès de Mountstuart Elphinstone, gouverneur de Bombay.
Car Burton avait un nouveau projet en tête - projet dont la réalisation
nécessitait d'importants appuis. Il se proposait en effet d'atteindre une
seconde cité sainte, cette fois totalement inviolée : Harar, la capitale
religieuse de la Somalie, perdue au cœur des déserts de la corne de l'Afrique2.
Citadelle de la foi musulmane dans cette partie du continent noir et nceud
important de la traite des esclaves, Harar n'avait été jusque-là visitée par
aucun Européen (seule la côte nord de la Somalie avait été explorée en 1848 par
un certain lieutenant Cuttendon, à partir d'Aden, possession britannique depuis
1839). La mystérieuse cité - racontaient les indigènes « çomals » - était gouvernée par un émir cruel et dépravé ;
elle était, à en croire une légende, promise à la décadence au cas où un «
infidèle » viendrait à y pénétrer.

Richard Francis Burton au milieu des années 1850...
Burton projetait de se
travestir en marchand musulman, et, à partir de Zeyla (au sud-est de Djibouti),
de rallier Zanzibar par Harar et l'Ogaden. Il devait finalement se borner à un
voyage aller-retour à la cité sainte, voyage dont il a laissé une relation, en
avant-première et en français, à l'intention des lecteurs de la Société de
Géographie de Paris.3
Pour son expédition,
Burton s'assura le concours de trois lieutenants de l'Armée des Indes, G.
Herne, W. Stroyan, et -- un nouveau venu - J.H. Speke, son futur compagnon
d'exploration dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Les deux premiers
furent chargés de reconnaître les alentours de Berbera ; Speke, quant à lui,
devait s'aventurer dans une vallée que l'on disait riche en gisements d'or, le
Ouadi Nogal, au sud-est de Berbera. Burton, enfin, se réserva le raid sur
Harar. Les quatre hommes devaient se rejoindre sur la côte le 15 janvier 1855.
Burton (qui reste laconique ou évasif sur certains points dans sa lettre à la
Société de Géographie) revêtit son déguisement de négociant arabe le 24 octobre
1854, et s'embarqua à Aden pour Zayla. Il recruta sur place neuf indigènes,
dont deux femmes, auxquelles il donna les noms de Sheherazade et Deenarzade
(deux personnages des Mille et Une Nuits). Le chef de sa caravane, un Yéménite
qu'il surnomma « End of Time » (« La Fin des Temps ») était un
véritable gredin, « cupide et sournois », mais sa connaissance des
proverbes arabes -- qualité qui, aux yeux de Burton, rachetait tous les vices -
était littéralement prodigieuse ; il devait lui servir d'interprète dans ses
contacts avec les bédouins Somali. Sous un ciel embrasé, Burton et son insolite
cortège s'engagèrent dans le désert infesté de scorpions. La couleur de la peau
de l'explorateur anglais ne tarda pas à attirer l'attention des populations
nomades. Pris pour un Turc (les Ottomans étaient haïs clans ces contrées), il
fut bientôt menacé de mort. « Une tête coupée ne repousse pas comme la
rose », l'avertit un Arabe. À Sagharrah, sept membres de la troupe refusèrent
d'aller plus loin. Burton jugea alors plus prudent de révéler tout bonnement
son identité, et de se faire passer pour l'envoyé du gouvernement d'Aden auprès
de l'émir d'Harar -- initiative qui devait probablement lui sauver la vie. On
lira comment, après dix jours de marche, Burton entra dans la ville -- l'un des
lieux les plus sinistres qu'il lui ait jamais été donné de voir. Les portes de
la mystérieuse cité se refermèrent derrière lui, et il fut conduit auprès de
l'émir, un jeune homme souffreteux, au teint cireux et « à l'air méchant »,
à qui il dévoila sa nationalité. Le souverain lui répondit par un sourire. Le
soir, Burton se retira dans ses quartiers, « épuisé de fatigue et
profondément impressionné par la poésie de sa situation » : « Je me trouvai sous le
toit d'un prince fanatique dont le maître mot était la mort, au milieu d'une
population qui détestait les étrangers ; et j'étais le seul Européen qui ait
franchi le seuil de leur inhospitalité, et, tout à la fois, l'instrument
désigné par le destin de leur chute future
»4.

Richard Francis Burton au milieu des années 1850...
Espionné en permanence,
incapable de prendre des notes, Burton s'aperçut bientôt qu'il était
prisonnier. Il parvint malgré tout à converser avec les érudits du lieu, qu'il
stupéfia par sa connaissance des choses de l'Orient. Il admira également la
beauté des femmes, dont les yeux étaient fardés de khôl et les mains teintes au
henné. Dix jours s'écoulèrent ainsi, mais les portes de la ville restaient
désespérément closes. Burton imagina alors un subterfuge : l'émir souffrant,
selon toute vraisemblance, de la tuberculose, il lui fit porter un message dans
lequel il lui proposait d'aller quérir à Aden des remèdes à son intention. Le
souverain, qui avait entendu parler des Anglais et craignait que ces derniers
ne saisissent ses caravanes d'esclaves, le laissa partir le 13 janvier 1855. Jamais
de sa vie Burton ne ressentit pareil soulagement : « Lorsque nous franchîmes
les portes, avec force salamalecs à l'adresse des gardes, toute mon angoisse
m'abandonna, comme si un manteau de plomb me tombait des épaules. »
Accueilli avec des cris
de joie à Sagharrah par les membres de sa caravane - qui le croyaient mort
depuis longtemps - Burton, par pure bravade, regagna la côte seul, en cinq
jours, en coupant directement à travers les monts Girki, où la température
pouvait atteindre 50° dans la journée. Le 9 février, il était de retour à Aden
avec Herne et Stroyan ; Speke les y rejoignit deux semaines plus tard ; sans
avoir réussi à trouver le Ouadi Nogal.
First
Footsteps in East Africa, la relation que
Burton a laissée de ce bref voyage, parut en 1856, avec, en annexe, un
glossaire de la langue harari, une étude sur la pratique barbare de l'infibulation
(la première qui ait jamais été publiée en anglais), et le récit de Speke de
son infructueuse incursion au cceur de la Somalie, copieusement mutilé et
réécrit par Burton (la haine que se voueront plus tard les deux hommes trouve
peut-être là ses toutes premières origines).

Harar ; Cliché de Jon Bratt
Dès son retour, comme
il le laisse entendre dans sa lettre, Burton mit sur pied une seconde
expédition. Il voyait cette fois beaucoup plus loin : il comptait retourner à
Harar, puis, après avoir traversé l'Éthiopie, rechercher les sources du Nil -
l'un des derniers grands problèmes géographiques non encore résolus en ce
troisième quart du XIXe siècle. Il avait entendu parler à Harar
d'une route caravanière qui traversait l'Afrique de la Somalie à l'Atlantique.
Avec Speke, Stroyan, Herne et quarante-deux hommes, Burton débarqua à Berbera à
la mi-avril 1855 et alla camper sur le rivage pour les préparatifs du départ.
Les chefs locaux, avec qui Speke avait eu maille à partir quelques mois plus
tôt, et qui considéraient la présence anglaise comme une menace sur la traite
des esclaves, virent d'un mauvais ceil l'arrivée de l'expédition. Dans la nuit
du 19 au 20 avril, cette dernière tourna d la tragédie : à deux heures du
matin, plusieurs dizaines d'indigènes armés de lances fondirent sur le
campement. Un furieux combat s'engagea alors : les quatre officiers réussirent
à tuer plusieurs assaillants, mais, dans la mêlée, Burton reçut en plein visage
une javeline qui lui transperça les deux joues et le palais. Fou de douleur, il
réussit à fuir vers la plage, où un navire ami était ancré, et à chercher des
secours. Herne et Speke, miraculeusement, parvinrent eux aussi à s'enfuir. Le
second avait pourtant vu de très près la mort : fait prisonnier, les bras
entravés, il avait été lardé de onze coups de lance ; dans un dernier sursaut,
il avait défait ses liens, projeté à terre son tortionnaire, et couru vers le
bateau. Quant à Stroyan, son corps devait être retrouvé un peu plus tard,
affreusement mutilé. Anéanti, Burton regagna Aden, où il guérit lentement de sa
blessure. Ainsi avait pris fin son « second voyage à Harar ». Et ce n'est
que deux ans plus tard qu'il repartirait, avec Speke, à la recherche des
sources du Nil.
Notes
1. L'ouvrage,
en trois volumes, paraîtra en 1855-56 sous le titre de Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah.
2. Voir Fawn Brodie, The Devil Drives, A life of Sir Richard Burton, 1986, pp. 106-125 ; B. Farwell, Burton, 1963, pp. 99-126.
3. Le
récit complet de cette expédition et de la suivante, paraîtra en 1856 sous le
titre de First Footsteps in East Africa,
XLII-648 p. ; London, Longmans.
4. First Footsteps…, p. 303.
(Extrait
d’après : R. F. Burton, Voyages à la
Mecque et chez les Mormons, augmentés d’une lettre de l’auteur sur son voyage à
la cité sainte et interdite de Harar ; préface de P. Conrad ; Éd.
Pygmalion, 1991, pp. 107-110)
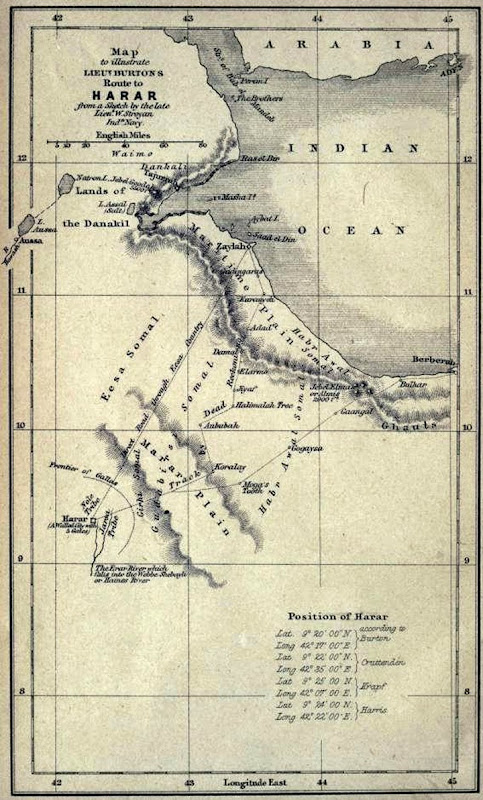
MÉMOIRE
SUR LA ROUTE DE ZAYLA À
HARAR
(AFRIQUE ORIENTALE).
LETTRE DE RICHARD F.
BURTON
À M. LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS1.
Aden, le 24 février
1855.
Monsieur,
Je
prends la liberté de vous adresser ci-joint l'humble témoignage de mon respect
pour une Société qui exerce son bienveillant patronage sur nous autres
voyageurs2.
Je
fus nommé, le 23 août, par la très honorable cour des directeurs de l'empire
des Indes, chef d'une mission plutôt exploratrice que scientifique. Un de nos géographes
les plus distingués, l’amiral sir Charles Malcolm, qui nous a été
malheureusement enlevé, avait depuis longtemps usé de son influence auprès de
la Société royale géographique de Londres, pour se procurer quelques
informations sur la région inconnue habitée par la nation Çomal (Somali)3. Le premier projet connu pour arriver à ce but
date de l’an 1849. Une seule difficulté se présentait à son exécution, mais
elle était considérable. C'était le mauvais renom que s'était acquis cette
nation.
En
18524, ayant accompli sans encombre
le pèlerinage de La Mecque, après avoir visité Médine, je pensais qu'avec la
réputation de hadji, je pourrais
réussir à traverser le pays des Çomals, peuple quasi musulman. Je soumis en
conséquence mon projet à lord Elphinstone, gouverneur actuel de Bombay. C'est à
ce nom si cher à l’Inde orientale que je dois l’heureuse réussite de mes
efforts.

Arrivée en vue de Berberah à bord du Tuna...
Je
m'embarquai à Bombay pour Aden, le 1er juillet 1854, avec un de mes
adjoints, le lieutenant Herne. Aden était un point favorable à nos desseins
d'étudier la langue et les mœurs du peuple Çomal. Malheureusement ceux de mes
compatriotes qui habitent cette colonie jugèrent défavorablement mes projets ;
je fus représenté comme un voyageur fanatique résolu à prodiguer sa vie et
celle des autres pour ne recueillir que quelques faibles informations
philologiques et autres. Les journaux reproduisirent ce jugement, et le public
étant le maître, je dus céder à une opinion égarée ; autrement j'eusse couru le
risque de voir mes projets chéris brisés par ce petit orage populaire. Je fus
consolé en partie par deux aimables Français, dont je tais ici les noms pour ne
pas blesser leur modestie et qui m'assurèrent de leur hospitalité si jamais
nous arrivions à Zanzibar.
Changeant
donc de plan, je détachai le lieutenant Speke5,
un autre de mes compagnons, avec ordre de visiter un pays de moins mauvaise
réputation, la région inconnue d'Ouadi Nogal. Et pour prouver la valeur d'un hadji, je résolus de visiter Harar (Hurrur), cité célèbre de l’Afrique
orientale qui a réussi jusqu'ici à fermer ses portes aux voyageurs européens.
MM. Krapf et Isenberg, M. Rochet (d'Héricourt)6,
le capitaine Barker, le lieutenant Christopher (sans nommer une foule moins
connue), n'ont pu pénétrer dans ce Tombouctou de l’Orient. Par précaution je
détachai le lieutenant Herne avec mission de s'établir à Berbera pour nous
venir en aide en cas de malheur, et la suite prouva que j'avais sagement agi.
Le despote de Harar me donna permission de pénétrer chez lui, en conséquence,
dit-on, de la terreur populaire inspirée par mon « frère » de Berbera qu'on
supposait posté pour arrêter les caravanes de l’intérieur.

A Mosque And Its Minaret, Zeila, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Le
29 octobre, je me rendis, travesti en vrai Asiatique hétérogène, à Zayla, petit
port de la région çomale déjà connu par la description de .M. Rochet, et depuis
par les malheurs de la belle frégate le
Caïman. Je fus accueilli avec empressement par le gouverneur çomal, El Hadj
Scharmarké. Il avait reconnu, avec sa finesse orientale, sous le costume de
marchand pèlerin, l’officier anglais, et se doutait de quelque projet
politique. Sa bienveillance était même exagérée : je fus retenu pendant
vingt-huit jours, sous le prétexte d'attendre des mulets que j'avais eu soin de
payer quatre mois d'avance ; mais en réalité parce qu'ayant répondu pour ma
tête au gouvernement d'Aden, le bon Scharmarké se trouvait dans une position
assez critique. Les Çomals de la tribu Eesa venaient, en effet, d'égorger
Maçared, un de ses fils ; les Gallas des environs de Harar étaient, disait-on,
en révolte, les chemins étaient fermés et la petite vérole, affreuse épidémie
qui tire son origine de cette région, sévissait sur la ville de Harar. Vous
jugerez, Monsieur, si, lors de ma halte forcée à Zayla, je n'avais pas raison
de ressentir les craintes propres à celui qui, ayant vanté sa supériorité aux
autres, se voit menacé d'un double malheur.

Somali nomad near Zeila, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Après
mainte discussion, en hadji obstiné,
je remportai la victoire la plus complète. Le gouverneur de Zayla se vit forcé
de me trouver des munitions de voyage, des mulets et quatre chameaux pour ma
petite provision de tabac, de toiles, de coton, de riz et de dattes. Il envoya
chercher parmi les Eesa un petit chef ayant mission de me servir d'abban. Dans ce pays l’abban, qui correspond au ghafir du Sinaï, à l’akh du Hedjaz, et au rabia de l’Arabie orientale, se
constitue guide, courtier, protecteur et écorcheur des voyageurs. Sans sa
permission, on ne saurait traverser un mètre de terrain et, pour prix de ses
services, il demande sa nourriture et celle de ses parents, amis et
connaissances, de plus des cadeaux de drap et de tabac, sans compter les
nombreux articles qui éveillent sa cupidité. Dans les contrées éloignées de la
côte, l’abban devient maître de la
vie et des biens de son client. Enfin l’abban
constitue une mode très africaine pour la perception des impôts.

Nomads Walking Through The Desert Between Berbera And Zeila, Berbera Area ;
cliché de Éric Lafforgue
De
Zayla à Harar, il y a deux routes. La plus directe, qui compte dix fortes
étapes dans la direction du sud-ouest, traverse pendant huit journées le pays
des Eesa, et en deux jours les montagnes des Gallas de la tribu Nola. Le Hadj
Scharmarké ne jugea pas à propos de me faire prendre une voie pleine de
dangers. Car ces deux tribus ont hérité de leurs ancêtres l’abominable habitude
de la mutilation ; lâches et traîtres, ils reçoivent l’étranger avec hospitalité, le traversent à l’improviste
d'un coup de lance et celui qui tire le premier sang s'empresse de saisir un
signe positif de son exploit. Alors il se rend auprès de sa femme qui vante, en
poussant des hurlements de joie, la prouesse du maître. Dès lors ce dernier
porte comme en décoration, dans sa perruque touffue et beurrée, le « bàl » ou plume d'autruche, symbole de
l'héroïsme africain. Le héros ne borne pas ses exploits aux hommes ; il égorge
encore les enfants et l'on m'a assuré qu'une femme perdrait la vie si l'on
avait espoir de trouver dans ses flancs un embryon mâle. Les bonnes qualités des
Eesa sont la générosité et l’habitude de la vérité : chez eux le parjure
est assez rare.

Father And His Son In The Middle Of The Village Square With Sheep Wandering Around, Zeila, Somaliland ;
cliché de Éric Lafforgue
La
seconde route qui côtoie la mer dans la direction du sud est plus longue, mais
elle est moins dangereuse. C'est celle-là que le bon Scharmarké me fit suivre.

Driving Through The Desert Between Berbera And Zeila, Berbera Area, Somaliland ;
cliché de Éric Lafforgue
Le
27 novembre 1854, à trois heures après midi, je quittai la ville de Zayla pour
traverser les plaines situées entre les montagnes et la mer. Ma caravane
comptait une vingtaine de personnes dont la plupart portaient des lances, des
boucliers et de longues dagues. Deux Çomals de la police d'Aden, qui avaient
reçu ordre de m'accompagner, étaient armés comme moi-même de longues carabines ;
j'avais de plus deux pistolets à six coups (invention Colt), arme qui cause le
plus grand effroi aux Bédouins.

Zeila mosque, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Nous
traversâmes au petit pas une plaine desséchée dont le sol, imprégné de nitrate,
ne produit rien que des plantes salines propres à la nourriture des chameaux.
On remarque des « fiumare » où après
les pluies violentes de la « mousson » africaine, les eaux des montagnes
forment des torrents dangereux. Les dépressions de cette plaine portent, auprès
de la mer, trace d'une inondation récente. À quelque distance de la côte, on
trouve une végétation suffisant à la nourriture des vastes troupeaux de
moutons, de chèvres et de chameaux qui forment la richesse des Bédouins. Quand
les pluies automnales ont fertilisé cette plaine, les nomades quittent leurs
montagnes pour jouir du soleil et pour le pâturage de leurs bestiaux. Mais en
été nul être humain ne saurait résister au simoun
et aux terribles ardeurs de cette région qui se change alors en un affreux
désert. L'étendue de la plaine peut être de 45 à 48 milles anglais (mes.
géographique). J'eus soin de visiter les campements des Bédouins qui me
reçurent avec empressement : des tribus hostiles dévastaient le pays, et dans
ce cas un pèlerin armé jusqu'aux dents, habile tireur et un peu magicien tel
que je leur paraissais, était doublement formidable. Les huttes de Çomals,
appelées gurgi, ont une forme
arrondie au sommet, leur hauteur est à peine celle d'un homme ; elles sont
composées de branches pliées en demi-cercles supportant des nattes tissées par
les femmes. Leur disposition circulaire rappelle le kraal des Cafres du Cap. Les petites divisions du centre protègent
les nouveaux-nés ; on parque les vaches ou les chameaux au milieu ; les huttes
sont disposées à l'entour et le tout est entouré d'une haute et large haie de
buisson et d'épines sèches. Telle est la disposition du rer ou village çomal. Il n'y a d'autre clôture qu'un monceau de
branches d'acacias. Les habitations sont sans luxe ; une peau de vache sert de
lit. Le lait, nourriture ordinaire de ces Bédouins, est caillé dans des outres
de chèvre et des petits seaux ; en hiver on trouve dans ces huttes un feu sans
cheminée et pendant la nuit, le propriétaire, sa femme et sa famille partagent
l'abri et la fumée avec les faibles et frêles agneaux.

Berbera coast, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Nous
traversâmes cette plaine, voyageant à la mode du pays, c'est-à-dire en
paresseux. Les Çomals divisent leurs routes en gedi ou marches de quatre à cinq heures. Une demi-gedi par jour est le maximum de leurs
efforts. Chemin faisant le voyageur distribue ses effets et sa provision aux bonnes
gens qui, en effrontés mendiants, assiègent sa hune avec des grands cris de wah issi : « donne-moi quelque
chose !7 ». Viennent des haltes fréquentes
sous prétexte de danger, de maladie, de faiblesse. Quand les provisions leur
manquent, les Çomals sont capables d'accomplir deux gedis par jour, marchant assez lestement. De quatre à huit heures
du matin, et deux heures dans la soirée. Enfin dans les endroits dangereux ils
vous mènent à grands pas depuis l’aurore jusqu'à la nuit. J'ai vu en mainte
occasion une caravane faire d'un trait 28 milles. Mais le voyageur ne doit pas s'attendre
â voir souvent des exemples d'une pareille célérité. Ces sauvages sont mous,
faibles et fainéants. Ainsi tout conspire à former une chaîne d'obstacles qui
ne se rompt que par le moyen d'un grand flegme.

Refugee camp in Lughaye, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Le
3 décembre nous arrivâmes à la frontière méridionale des Eesa, et nous passâmes
quelques journées assez confortables au pied de la montagne qui forme le
premier gradin de l'Abyssinie alpine. Cette chaîne suit la mer depuis Tajouzzat
jusqu'à Jerd Hafoun (Guardafui) : sa formation géologique présente
successivement du calcaire, du grès et des terrains cristallins dans les
régions élevées. Ici nous trouvâmes un climat plus frais, et un pays fertilisé
par les pluies hivernales. Le 7 décembre nous enfilâmes le lit aride d'un
torrent, seul zigzag connu par ces nations primitives, et nos chameaux
grimpèrent avec difficulté un sentier pénible parsemé de granites, de grès et
de pierraille disposés en gradins ou par grosses masses détachées. Les granites
de cette montagne étaient tellement bruts que le quartz, le mica et le
feldspath se trouvaient séparés l'un de l'autre. On remarquait des lignes de
torrents et de cataractes qui se dessinaient sur les flancs arides et noirâtres
des montagnes. Ce pays se change en désert avant la saison des pluies ;
fertilisé par la « mousson » (juin-septembre), il nourrit à peine une
faible population de vaches nomades. On y trouve des gazelles, des autruches,
des couaggas8 et plusieurs autres
espèces de bêtes fauves ; le daim nain, appelé par les Abyssins, Beni israil, et par les Çomals, Sagaro ; enfin des petits lièvres et des
gros rats. Les lions font l'horreur des timides habitants : pendant mon voyage
je ne vis qu'un seul de ces animaux qui s'esquiva d'un coup de carabine porté
au clair de la lune. Une espèce de perdrix ou plutôt de poule sauvage et connue
sous le nom de kabk (aux amateurs de
la poésie persane), se trouve sous tous les buissons. Ce qui m'étonnait,
c'était la timidité du gibier dans un pays où les armes à feu sont inconnues et
dont les natifs affamés détestent la volaille.

Portrait Of A Senior Man Wearing A White Beard, Lughaya, Somaliland ;
cliché de Éric Lafforgue
Sur
ces montagnes nous trouvâmes un terrain aride présentant une succession de
petites collines couvertes d'acacias, de plaines desséchées où les cailloux
servaient de gazon et de vallons portant les marques de fiumare violentes. La fraîcheur de l'air indiquait une altitude
considérable et le pays s'élevait à l'occident. Ici habitent les Çomals
Gudabursi, petite tribu d'environ 10 000 boucliers qui, grâce à ses montagnes
et à ses chevaux, se maintient pied ferme, contre les 100 000 Eesas. Ils sont
d'ailleurs renommés pour leur caractère hospitalier et la vie des voyageurs est
chez eux en sûreté. Je ne saurais toutefois répondre de ses biens, car les
Gudabursi sont d'une avidité remarquable ; le mensonge, la fausseté et la
mesquinerie dénotent leur ignoble origine. Ces sauvages sont des Çomals,
dit-on, de famille bâtarde.

Berbera old town beauty Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Du
3 au 23 décembre, nous traversâmes ces montagnes, marchant un jour sur cinq de
halte. Le 9, je visitai une ancienne ville que les Bédouins appelaient Darbiyah
Kolah (le fort de Kolah : ce nom est celui de sa reine) ; il est probablement
d'origine galla. On y remarque des ruines de mosquées et de tombeaux musulmans.
La seule tradition que j'aie pu recueillir à ce sujet, c'est que la ville a
toujours été en guerre avec Aububah, sa voisine, et que les deux cités se sont
mutuellement détruites. Les ruines sont composées de pierres, les unes non
équarries ; les autres taillées ; l'argile y sert, comme c'est l'ordinaire dans
ce pays, de mortier. Mais la race qui faisait là son domicile était bien
supérieure aux nomades propriétaires actuels du sol, qui regardent les restes
des awwalin (les anciens) avec un œil
craintif et stupide. Les Oulemas de
Harar n'ont pu éclaircir mon ignorance sur ce sujet qui n'est pas sans intérêt.
Le 11 décembre, je visitai Aububah dont les ruines se réduisent à un petit dôme
d'architecture grossière où gît un schaykh
musulman. Les Bédouins donnaient le nom d'Aububah à la ville, au vallon, au
saint. Cependant le savant Schaych Tami, dont je fis la connaissance à Harar,
m'assura que ce personnage était de la famille d'Abu Zerbay (Abou Zerbin) qui,
en l'an 1429, enseigna aux Arabes les luges africains du café et du cat. J'eus soin de faire mon pèlerinage
près des restes d'un saint si amateur du confortable. Il repose auprès de la
porte méridionale de Zayla.

Waiting for qat Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Le
14 décembre, étant campé sur les bords de la grande vallée Harawwah, où,
disait-on, les éléphants broutent comme des brebis, je forçai à coups de poing
le nommé Beuhh, mon abban gudabursi,
à seller sa rossinante. Je montai avec ma carabine et suivi de
Mohammed-Mahmoud, mon fidèle Çomal, je parcourus la vallée de part et d'autre.
C'est une dépression qui porte les eaux des montagnes au pays des Danakil non
loin de Tajourrah. Dans cette forêt (remplie d'acacias et du cactus que
recherche l'éléphant), les mouches, peste du pays çomal, et le soleil, nous
faisaient endurer des tourments que l'espérance seule de la réussite rendait
supportables. Espérance, hélas chimérique ! - vaines visions de la porte
d'ivoire ! Après cinq ou six heures de course, nous retournâmes joyeux comme
retournent toujours les chasseurs désappointés, en faisant manger des
abominations (la phrase est orientale) à Beuhh, à ses confrères et généralement
à sa tribu.

Woman Passing By A Street In Baligubadl
Le
23 décembre, nous traversâmes le ban
Marar, ou prairie de Marar, campagne herbeuse qui sépare le premier gradin
du second. Sa longueur est plus considérable, m'assura-t-on, que sa largeur et
celle-ci n'est pas moins de 28 milles. La surface de cette plaine ondulée était
couverte d'une végétation desséchée ; au milieu, nous traversâmes une ouady (fiumara) où s'arrêtèrent les Çomals pour manger la gomme des
acacias. Nous convoyâmes une petite caravane composée de quatre chameaux, douze
vaches et une cinquantaine d'ânes accompagnés, comme toujours, dans ces pays
peu galants, d'un nombre égal de femmes lourdement chargées. Elle allait aux
montagnes des Girhi pour troquer le beurre et les cuirs du pays bas contre 1e hurud ou Holcus sorghum des cultivateurs9.
Cette plaine est un rendez-vous de voleurs et de brigands ; les Gudabursis, les
Eesa, les Habr Avals et les Berteris s'y disputent les dépouilles du malheureux
voyageur. Nous partîmes à six heures du matin et nous arrivâmes sous les
montagnes de Harar à huit heures du soir, sans qu'aucun de nous eût couru de
danger.

Coming back from the well in Degehabur, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Le
bon Schermarké m'avait muni d'une lettre adressée au gérad Adan (le prince Adan, corruption çomale de Adam), chef de la
tribu girhi. Malheureusement notre guide gudabursi était beau-frère du gérad : par conséquent, ils avaient eu
des disputes de femme, de famille et de tribu. En pareilles circonstances, l’habitude
du pays est peu commode pour l’étranger : les deux parties ne s'accordent qu'à
lui refuser passage. Après maints doutes, discussions et délais, le gérad nous envoya son fils aîné,
Scherwa, et une de ses six princesses, la bonne viveuse Dahabo, sœur de Beuhh.
Le 26 décembre nous entrâmes dans les montagnes des Girhi, où s'offrit soudain
à nous une scène tout à fait nouvelle.

Berbera, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Le
pays est montagneux et la végétation alpine. Une espèce de pin que les Arabes
nomment Sinaubar, les Çomals Dayyib,
donne un sombre aspect aux flancs et aux sommets des rochers dépouillés de
terre par des pluies furieuses. La présence de cet arbre dénote une altitude de
5 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, comme l’a constaté le lieutenant
Herne sur les cimes du mont Gulap, non loin de Berbera. Nous contemplâmes avec
joie, dans ces fertiles vallées, des ruisseaux d'eau pure, le plus charmant
spectacle qu'offre l’Orient au voyageur altéré. Pour la première fois depuis
que j'avais quitté l’Inde, je vis des traces d'agriculture. C'était le temps de
la moisson, et les paysans (nous avons quitté les Bédouins) chantaient gaiement
pendant leur doux travail. Ils nous entourèrent, nous témoignant une curiosité
encore plus vive que celle qu'avaient montrée les nomades, et je dus massacrer
quelques malheureux vautours ou percnoptères pour me délivrer des importuns.

Sheikh Hussein hills, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue
Nous
demeurâmes six jours sous la protection du gérad
Adan. La cause de ce nouveau délai a tout à fait le coloris local. Mes deux
Çomals virent avec effroi mon intention arrêtée d'entrer dans la funeste ville
de Harar. On me conjura d'adresser une parole au sultan ; on m'ennuya avec des
contes de diables et de dragons ; on ourdit même contre moi de petites
conspirations. Tantôt les chameaux ne pouvaient marcher ; tantôt on ne voulait
pas aller chercher des ânes pour le transport de nos effets. Pauvres gens ! Ils
ne pouvaient triompher de l’opiniâtreté d'un hadji. Le 2 janvier 1855, je me décidai à partir seul sur mon
mulet, muni d'une lettre du gouvernement d'Aden, avec l’intention de me
présenter au sultan. Alors les Çomals eurent honte de me laisser partir comme
un gueux. Les deux policemen, le cœur brisé, m'accompagnèrent donc, et un
troisième, qui cachait avec peine sa joie, resta auprès du gérad Adan pour garder mes effets et pour remettre au lieutenant
Herne, au cas où je serais retenu prisonnier, une lettre d'avis. Je résolus de
me présenter comme un émissaire anglais pour deux raisons : 1° les Çomals
respectent peu l'homme qui en temps de danger nie sa patrie ou sa tribu ; 2° à
mesure que j'approchais d'Harar, la population me croyait davantage Turc, -
nation ignoble, plus détestée dans ces régions que le Feringhi. - Le 3 janvier, j'entrai à Harar où je fus reçu
passablement par le sultan, d'ailleurs assez méchant homme. Sans entrer dans le
détail de mille petits événements qui se succédèrent pendant mon séjour de dix
journées, - Allah ! Qu’elles étaient longues ! - je dirai seulement qu'on me
congédia avec deux mulets et une lettre adressée au gouvernement d'Aden*.
L'ancienne métropole de l'empire hadiyah est située à peu près à 175 milles de
Zayla, et à 219 milles de Berbera : la direction est respectivement 220 et 257
degrés. Cette évaluation donne une latitude de 9° 20' N. et une longitude de
42° 17' E.

Teenage Girl With A Black Hijab Covering Her Hair And Quasil On Her Face, Berbera, Somaliland ;
cliché de Éric Lafforgue
*
Ci-dessous est la liste des stations. Je dois prévenir toutefois que les seuls
instruments que mon caractère de hadji
me permit d'avoir, étaient une montre, une petite boussole et un thermomètre.
Direction Distance en milles anglais
1.
De Zayla à Gudingaras. S.-E. ………. 165° 19
2.
De Gudingaras à Kuranseli ………… 145° 8
3.
De Kuranseli à Adad ………………. 225° 25
4.
De Adad à Damal …………………. 205° 11
5.
De Damal à Ilarmo ……………….. 190° 11
6.
De Ilarmo à Tujaf ………………… 202° 10
7.
De Tujaf à Halimalah …………….. 192° 7
------ -----
Ici
il y a un sycomore célèbre réputé moitié chemin. 91 mill.
8.
De Halimalah à Aububah ………… 245° 21
9.
De Aububah à Koralay …………… 165° 25
10.
De Koralay à Harar ……………… 260° 65
-----
Total
…………………………………………………………………. 202
La
direction de Harar qui me fut donnée par les natifs de Zayla, est S.-O. 222°.
De
Zayla à Harar le mukattib (courrier) arrive à pied en 5 jours, dit-on. Les
caravanes les plus lestes prennent 11 jours, les plus lentes de 11 à 12.
Thermomètre
(Fahrenheit) à Zayla … 210° (eau
bouillante)
--- --- à Halimalah … 204°
--- --- à Koralay … 201°
--- --- à Harar … 200°
(de
Greenwich) : elle répand assez bien aux estimations de nos géographes.
Lat.
9° 22' N. Le lieut. Cruttenden (marine
Indes).
Long.
42° 35' E.
Lat.
9° 25' N. Le missionnaire Krapf.
Long.
42° 07' E.
Lat.
9° 24' N. Le capitaine Harvis (armée
Indes).
Long.
42° 22' E.

Multi Colored Window Inside "Rimbaud House", Harar, Ethiopia ; cliché de Éric Lafforgue
Mon
thermomètre indiquait une hauteur d'environ 5 500 pieds anglais au-dessus du
niveau de la mer. Cette ville est sur la pente d'une colline, dont la déclivité
est de l'ouest à l'est. À l'orient on remarque des jardins de bananiers, de
citronniers, de caféiers, de cât et de vars (bastard saffran) ; il y a aussi des limoniers, du raisin sans
fruit, des dattiers qui ne portent pas de dattes et de la canne à sucre. Le
terrain de l'occident est disposé en terrasses pour l'irrigation des jardins ;
au nord il existe une petite colline qui constitue le « Père la Chaise »
de cette ville sainte, et au sud les habitations sont bâties dans une
dépression considérable.

Harar blue walls ; cliché de Éric Lafforgue
Le
climat m'a paru délicieux, ni chaud ni froid. Trois fois en onze jours nous
eûmes de la pluie ; l'air était frais et le soleil supportable. L'eau gelait
dans les montagnes voisines ; dans la ville la température était plus modérée.
Les habitants parlaient de six mois de « mousson » : on s'explique ainsi
la fertilité prodigieuse du sol.

Harar ; illustration de First Footsteps in East Africa
Harar
fut bâtie, il y a trois cent seize ans, par l'émir Nur, prince dévot qui occupe
un grand vilain tombeau placé sous un petit dôme. Dans les jours de Mohammed-Gragne,
cet Attila musulman qui menaçait de brûler et de ravager l'empire chrétien de
l'Abyssinie, c'était un amas de misérables bourgades. L'émir fit construire une
muraille avec des tourelles qui subsiste encore. L'histoire moderne de cette
ville n'a rien d'intéressant ; elle se borne au jihad (croisades) contre les Gallas païens et aux querelles
intestines d'une grande famille de petits despotes.

Harar girl ; cliché de Éric Lafforgue
La
ville ne contient rien de remarquable. Elle a cinq portes d'une grandeur
vraiment orientale ; à savoir :
1.
À l'est, Argob Bari.
2.
Au nord, Asum Bari.
3.
À l'ouest, Asmadein Bari.
4
Au sud, Badro Bari.
5.
Au sud-est, Sukutal Bani10.

El Hammal Mohammed Mahmud ; illustration de First Footsteps in East Africa
La
jami, ou mosquée-cathédrale, est un
édifice peu artificiel qui ressemble à une grange européenne. Il a deux
minarets d'architecture grossière et de forme remarquable. On m'a assuré que
c'est un produit de l’art turc. La ville est d'un aspect sombre et morne ; cette
apparence est due à l’absence du mortier, laquelle donne aux villes de l’Orient
un reflet fatigant. Les maisons sont construites en granite et en calcaire
disposés par masses grossières rangées sans ordre et, unies par le moyen de
couches de bois et d'argile. Les toits sont plats et peu d'habitations ont un
second étage. On entre par une porte faite de grosses tiges de Holcus, dans une basse-cour au fond de
laquelle se trouve la maison. Les femmes, ainsi que cela a toujours lieu dans
les pays musulmans, sont séparées des hommes. Pour rues on ne trouve que des
allées, des culs-de-sac et de rudes escaliers fort pénibles à escalader. La
ville ne contient pas un seul jardin ; on y voit quelques arbres (le Ficus religiosa ?) et bon nombre de
cimetières.

Street kid in Harar ; cliché de Éric Lafforgue
Harar
renferme une population d'environ 10 000 âmes ; y compris 2 500 Çomals et sans
compter une large population flottante de Gallas et de Bédouins. Les femmes
sont extraordinairement nombreuses, fait qui est dû à l’esclavage. Je ne juge
pas très favorablement des mœurs et du personnel des habitants de cette ville.
Ils sont tellement adonnés à la boisson que les Oulémas mêmes ne sauraient résister aux charmes du tej ((hydromel), et du farshu (bière connue en Orient sous le
nom de bouzat11. L'émir a dû établir pour la correction
des mœurs, un guet de nuit qui surveille les ruelles en appliquant une
bastonnade préparative de la prison aux voleurs et aux amoureux. Les hommes
ont, dit-on, mauvais cœur; je certifie qu'ils n'ont pas moins bonne mine : ils
souffrent de l'ophtalmie, des scrofules et d'autres maladies plus civilisées et
plus terribles. La toilette est très simple, une tobe (toga abyssinienne) et des sandales grossières, quelquefois
une calotte blanche sur la tête rase et un futat
ou drap autour des reins. Le port des armes étant défendu dans la ville, on
sort avec un bâton de cinq pieds de long. Les femmes sont assez gentilles :
leur bouche est, presque européenne et la ligne des traits est quasi
caucasienne.

Harar girl in her house ; cliché de Éric Lafforgue
Elles
s'habillent avec une chemise de coton teinte en bleu foncé avec deux triangles
écarlates sur la poitrine et le dos. Cette simple toilette est relevée
extérieurement par une écharpe de coton fabriquée à Harar. Les femmes marchent
pieds nus et, quand elles sortent elles ne se voilent pas la figure. Leur tête
est couverte de mousseline bleue, et leurs cheveux sont attachés de façon à
former deux gros pelotons sous les oreilles. Leur parure se compose de
bracelets, cercles en corne de buffle fabriqués dans l'Inde, de colliers de
corail, d'épingles dorées qu'on met dans les cheveux, d'un ruban de satin noir
qu'on passe autour de la tête, et de bagues de fabrique « birminghamaise ». Ces
dames ont la voix excessivement rauque, - contraste défavorable avec la nation
çomale dont la moitié féminine possède un organe doux et flûté qu'on retrouve
quelquefois parmi les négresses. Puellarum
suta sunt pudenda more Gallarum et Somalarum ; nova nupta solvitur cultello12. - Précaution extraordinaire et très
efficace, indigène de l'Afrique qui, comme on l’a dit, aei pherei ti khainon13.
Les femmes de Harar aiment éperdument le tabac, employé comme chique, et inter pocula14,
elles rivalisent avec les hommes. Je n'ai eu aucune difficulté à entamer de
longues conversations avec ces aimables citoyennes : n'ayant jamais vu de
visage européen, elles me trouvèrent beau (circonstance exceptionnelle) et ici
les propositions se font avec l'aimable abandon de la mode putipharienne.15

Harar ; cliché de Roel
Harar
est riche en saints, en érudits et en fanatiques. Les Shaychs, Abadil el Bekri,
et Ao Rahmah y ayant laissé leur précieuse dépouille, ont rendu la ville
fameuse dans l’hagiographie musulmane. Les Oulémas
les plus célèbres sont le kabir Khalil et le kabir Yunis. Je fréquentai la
sagesse de Harar, dont l’érudition me parut bornée aux sciences purement
religieuses. Les livres sont assez abondants. Je remarquai des kamous et des manuscrits élégamment et
correctement écrits. Les habitants de Harar se sont acquis une célébrité pour
la reliure des livres et un Persan, dont je fis la connaissance à Harar,
m'assura que même à Schiraz il n'avait rien vu de semblable. Au reste, il n'y a
point de collège, point de wakf
(fondation), point d'encouragement pour les étudiants. Les Bédouins du
voisinage sont infestés par des widad
(caiottins) qui savent lire le Coran, sans pourtant le comprendre, écrire un
peu et réciter une multitude de prières. Grâce à ces connaissances, ils
espèrent pouvoir vivre gratis et en « dulce
otium16 », - but universel de
l’ecclésiastique dans les pays chauds où l'homme est paresseux.

Selling at the market in the old town of harar ; cliché Anthony Pappone
Les
habitants de Harar parlent une langue tout à fait différente de celle des
Gallas, des Çomals et des Amhares. J'ai composé de cette langue un essai de
grammaire et un vocabulaire d'à peu près 1500 mots. Cet aperçu pourra peut-être
satisfaire, en attendant mieux, les philologues. Comme c'est l'ordinaire dans
ces pays, la langue me paraît un dialecte sémitique greffé sur un idiome
indigène. La consonne dominante est le khá,
son rauque et guttural. Les hommes qui ont reçu quelque éducation parlent la
langue arabe ; on comprend aussi à Harar l’amharique, le galla, la langue des
Çomals et celle des Danakils.

Costumes de Harar ; illustration de First Footsteps in East Africa
Quatre
tribus de Gallas s'étendent jusqu'aux portes de la ville :
1.
Les Nola, à l'est et au nord-est.
2.
Les Alo, à l'occident.
3.
Les Babuli, au sud.
4.
Les Jársá, à l'est et au sud-est.

Harari women out of the gate of the old city of Harar ; cliché Anthony Pappone
Il
est impossible de voir cette nation sans s'apercevoir que c'est une race mêlée
de sang sémitique et indigène, descendant des Çomals qui, occupant la côte, ont
reçu de l'Arabie la grande pépinière de la race caucasienne, des subsides
fréquents de sang pur. Les Gallas ne sont nullement fanatiques : les chrétiens,
les musulmans et les païens qui adorent le wak
(Dieu) vivent lisiblement sous le même toit.

Girl in the narrow alleys of Old City of Harar ; cliché Anthony Pappone
Les
Gallas n'ont point à Harar la réputation que nous leur faisons. Ils pourraient
aisément anéantir la ville, mais l'émir paye à titre de solde, et en réalité
comme tribut, 600 à 700 tobes par
année aux chefs des Bédouins. Le Galla a le droit de porter sa lance dans les
rues ; quand il passe par la cour du palais, il ne trotte pas avec le bras
droit nu, ainsi que doivent faire les sujets de Son Altesse, et il boit son tej dans la maison des princes. En
revanche il est volé par les citoyens qui payent très bon marché pour son café,
son tabac, son wars et son beau
coton. L'émir punirait avec rigueur celui qui oserait enseigner aux Bédouins l’artifice
pernicieux des poids et des mesures.

Harar ; auteur non identifié
Le
gouvernement se réduit à l'émir. Ce petit prince, qui s'intitule El Sultan ibre El Sultan ibn El Sultan,
est, dit-on, d'origine galla, ce qui ne l’empêche pas de s'arroger le titre d'El Bekri (descendant du calife Aboubekr)17. C'est un jeune homme de vingt-trois à
vingt-quatre ans, frêle, petit, jaune, imberbe, au front plissé, aux yeux
saillants, ayant l’air méchant et l’aspect d'un petit rajah indien. Sa santé est faible, ce qui est peut-être l’effet
d'une potion que lui a administrée l’une de ses quatre femmes. Il a deux
enfants de jeune âge. Orphelin et despote depuis trois ans, il redoute une
cinquantaine de gros et forts cousins qui peuvent lui disputer le trône. Déjà
il a emprisonné trois d'entre eux, et comme à Harar le détenu vit enchaîné dans
un cachot noir, sans autre nourriture que la provision envoyée par la famille,
la prison et la mort sont ici à peu près synonymes. L'émir affecte toute
l'étiquette d'un grand monarque. Quand on lui est présenté, on est saisi par
ses gardes du corps et traîné au pied du trône, où il faut embrasser sa longue
main sèche et jaunâtre en dessus comme en dessous. On ne regarde pas en face
S.A. sans courir le risque de la discipline. S'il crache, un chambellan lui
présente le pan de sa robe. Dans les rues, des valets chassent sur le passage
du prince, à grands coups de fouet, les individus qui ne s'esquivent pas au cri
de : Let ! let ! (sauve-toi !) ; et dans la mosquée, deux ou trois
soldats, armés de fusils à mèche, veillent sur lui pendant qu'il fait sa
prière. Son wazir, le gérad Mohammed et sa mère, la Gisti Fát'meh,
malgré l'autorité du pouvoir maternel en Orient, n'osent lui donner le moindre
conseil. La princesse a même, m'assure-t-on, reçu parfois des reproches
accompagnés de menaces.

Ahmed Bin Akibakr, Amir of Harar ; illustration de First Footsteps in East Africa
La
loi criminelle est rigoureusement administrée à Harar. L'héritier de celui qui
périt victime d'un meurtre, coupe, avec un grand couteau, la gorge du
meurtrier. Le vol est puni par la mutilation de la main. Pour les petits
crimes, la peine est la fustigation : deux bourreaux appliquent de grands coups
de kurbach sur la poitrine et les
reins du criminel. Quand une femme est ainsi punie, on commence par verser de
l'eau sur sa personne, espèce de baptême que la délicatesse exige. Le cachot,
l'amende et surtout la confiscation totale sont le châtiment des offenses
politiques. L'émir est célèbre pour la promptitude de ses décisions.
Ordinairement il permet à ses sujets d'avoir recours à la sheriat (loi des oulémas).
Le cadhyl8,
Abd-el-Rahman, est un homme assez propre ; mais en règle générale, in urbe et orbi, les ministres de la
religion ne sont pas très exemplaires pour l’administration de la justice.
Thémis est une exigeante, jalouse des petits soins prodigués à une concurrence
quelconque. Ainsi, à Harar, si l'on court le risque d'être volé par l’émir, on
est encore sûr d'être écorché par le cadhy.

Harari women in the old city of Harar ; cliché Anthony Pappone
L'unique
monnaie de Harar est une petite pièce dont la face porte l’inscription : - Monnayage de Harar. - Aux revers on lit
la date A.H. (1248). On appelle cette pièce une mahallak (mot harari qui signifie argent) : 22 bananes valent une mahallak ; 22 mahallaks, une ashrasi,
valeur théorique de commerce, et 3 ashrasis,
le réal ou talari. L'émir punit sans
pitié ceux qui possèdent ou qui font circuler d'autres espèces.

Timkat festival, Harar ; cliché de Beth
Harar
est une ville essentiellement commerciale. La perception des droits est simple.
Toute marchandise paye pour octroi une tobe
de seize coudes par âne ; l'âne par conséquence passe les portes de la ville
supporté par quatre ou cinq portefaix. L'impôt des cultivateurs est 10 pour
100, tarif général du pays. On ne manque que d'argent : la marchandise est
rare, et celui qui possède un capital de 1 000 francs passe pour millionnaire.
On ne paye pas les employés au comptant : ils reçoivent le don d'un jardin de
caféiers, ou un réal (Marie-Thérèse) de grain, quantité suffisante pour la
nourriture annuelle d'une seule personne. Trois caravanes portent à Berbera les
riches produits du pays des Gallas : celles de janvier et de février sont peu
nombreuses ; celle de mars est composée de 2 000 hommes et 3 000 chameaux. Une
masse d'esclaves tirés de Gurague, d'Efat, et des différentes tribus gallas est
troquée avec les Arabes de Mascate contre des dattes et du riz. L'ivoire
constitue un monopole royal : l'émir achète avec de faibles cadeaux les
dépouilles de l'éléphant et les envoie à Berbera accompagnées d'un wakil. Je ne vous offre pas une
description du café, qui est déjà renommé en Europe. On sait qu'ici comme dans
le Yémen, pays où la nature a prodigué ce produit, les habitants se servent
rarement du fruit. Le Yéménite emploie la kischr
ou follicule, et le Harari prépare une boisson nauséabonde avec les feuilles
broyées après avoir été rôties dans un pot de métal. Le premier café, comme le
tabac, croît à Jarjar, pays des Gallas, à sept jours à l'ouest de Harar. L'émir
en défend une exportation trop considérable, craignant d'en diminuer la valeur;
aussi retient-il les hardsch, ou
cultivateurs, pour empêcher l'art de tomber en désuétude. On achète pour un
réal à peu près soixante-dix livres de tabac. Le wars est employé par les Arabes de Sur et de Mascate, qui s'en
servent comme cosmétique et pour la teinture des robes. Les tobes de Harar sont célèbres dans
l'Afrique orientale : tissées à la main, elles portent l'empreinte de cet
instrument divin, et dépassent de loin en beauté et en solidité les plus beaux
produits de nos ateliers mécaniques. Aussi sont-elles chères : on paye 10 et
même 15 réaux pour un article de première qualité. Le bétail est peu nombreux.
On mange ordinairement la viande de bœuf poudrée de piment et sans sel : Les
moutons et les chèvres sont rares. L'émir a une douzaine de mauvais petits
chevaux, bons seulement pour grimper les plus exécrables chemins. Les ânes sont
plus forts et plus vaillants que ceux du pays çomal. Les mulets sont excellents
: je marchai cinq jours et presque deux nuits monté sur le même animal qui n'arriva
que peu fatigué à Berbera. On les vend depuis 2 jusqu'à 40 réaux. Pour un réal
on achète cent vingt petits poulets. En un mot les comestibles sont abondants
et à bon marché. Ajoutez à ces produits la gomme, le beurre, les peaux de
bétail, le grain et les esclaves, et vous aurez une liste complète de
l'exportation de Harar. Elle serait considérable, si l’incertitude des chemins
et le danger de la vie n'augmentaient le louage des animaux et ne diminuaient
le nombre des marchands voyageurs.

Back lines harar ; cliché de Yujapi
Je
manquerais, Monsieur, à mon devoir de narrateur fidèle en laissant passer cette
occasion d'avertir mes confrères les voyageurs que cette ville n'offre aucun
objet de curiosité ou de jouissance. La destinée m'a tiré du danger sauf et
sain. Vous qui ne recherchez pas le trépas, évitez de visiter Harar pendant la
vie de l’émir, Ahmed-bin-Abubekr.

African wal martharar ; cliché de Yujapi
Je
ne vous donne aucune description de mon retour à Berbera, où j'arrivai le 13
janvier. Ce port célèbre et emporium
de l'Afrique orientale, vous est déjà connu. De Berbera, où mes adjoints, les
lieutenants Herne et Stroyan m'attendaient non sans inquiétude, je m'embarquai
pour Aden.

Harar Market ; cliché de Yujapi
Il
faut, pour pénétrer dans le pays des Çomals, faire une forte dépense de toiles,
tabac et munitions de bouche : le tout pour être pillé par messieurs les
sauvages. La libéralité du gouvernement des Indes me prodigue tout. Je suis à
présent à dépenser 15 000 francs pour une provision qui doit nous durer six
mois. J'ai trois adjoints : nous avons une petite troupe de domestiques armés,
et nous sommes munis de tous les instruments d'observation dont on peut se
servir dans un pays de sauvages soupçonneux et craintifs. Le mois d'avril nous
verra, j'espère, encore une fois réunis et préparés à entamer une seconde
entreprise19. Mon intention est
d'aborder à Berbera, de visiter les montagnes de Gulap, situées à deux fortes
journées dans la direction du sud, et d'y commencer une guerre acharnée contre
les éléphants, seule manière de s'acquérir une belle réputation, quand on
refuse de mutiler son prochain. Avant la « mousson » nous nous dirigerons vers
Ogadayne pour observer ce fleuve célèbre, le webbe Shebayli (Hamis' River). Après quoi - Allah kerim
! comme disent les vrais croyants, - Dieu est généreux !

The hyena man - Harar ; auteur non identifié
Comme
Moïse sur le mont Pisgah, nous, voyageurs, contemplons de loin la terre sainte
de la science. Daignez, Monsieur, nous accorder les instructions de la Société
géographique de France ; nous ne manquerons pas, selon nos moyens, de consulter
ses moindres désirs. Jusqu'à la fin d'avril prochain, une lettre (adressée au Lieutenant Burton, Bombay Army Commanding
Somali expedition, care of the Political Resident. Aden. Arabia) me sera
remise par mes amis.
Je
confie ces remarques à la politesse française qui pardonnera les erreurs
d'omission et de grammaire dans la langue la plus exacte de l'Europe.
Veuillez,
etc.
Rich. F. Burton

Hyenas Feeding Show, Harar ; cliché de Éric Lafforgue
NOTES
1
Extraite du Bulletin de la Société de Géographie de Paris (Juin 1855, pp.
337-362), cette lettre a été écrite directement en français par R. Burton.
2
Nous avons tenu à conserver à cette
lettre son style d'un caractère original bien qu'incorrect ; ces incorrections
étant fort excusables chez un étranger, nous nous sommes bornés à faire
quelques corrections indispensables (Note d’Alfred MAURY, Société de
Géographie, 1855).
3 Après avoir pris pied à Aden en 1839, les Anglais tentèrent
très vite d'étendre leur influence à la Corne de l'Afrique, quasi inexplorée.
La « Somalie britannique » ne verrait cependant le jour qu'en 1884.
4
Burton a un trou de mémoire : lire 1853.
5 Burton avait recruté
pour son expédition trois de ses anciens compagnons de l'armée des Indes, les
lts. Herne et Stroyan, et le surgeon
Stocks – ce dernier étant décédé entre-temps, Burton le remplaça par un jeune
volontaire qu'il ne connaissait pas, John Hanning Speke (1827-1864), lieutenant
du Régiment du Bengale - son futur
compagnon d'expédition en Afrique.
6 Ainsi les Arabes
désignent satiriquement le pays des Çomals par le nom de Bilard wah issi, -
Pays de donne-moi quelque chose (note de R. Burton)
7 Krapf
et Isenberg : missionnaires allemands au service de la Société anglaise des
missions, ils avaient exploré l’Abyssinie entre 1839 et 1843 ; Burton
avait rencontré Krapf au Caire en 1853 et l’avait interrogé sur le problème des
sources du Nil. – Rochet d’Héricourt : voyageur français, auteur de Voyage sur la côte orientale de la mer
Rouge, dans le pays d’Adel et le Royaume de Choa (Paris, Arthus
Bertrand, 1841) et de Second voyage sur les deux rives de la mer
Rouge dans le pays des Adels et le
royaume de Choa. (Paris, Arthus
Bertrand, 1846)
8 Ce grain est très
commun dans le Scinde et l'Arabie : ici on l'appelle taam, là le jowan ; hurud est le mot çomal (note
de R. Burton).
9
Bari dans la langue de Harar signifie une
porte. C'est le bar des Amhares,
comme dans « anco-bar », etc. (note de R. Burton).
10 L'histoire de ce mot
est assez extraordinaire ; il est connu depuis l'Égypte jusqu'à la Tartarie.
Aussi a-t-il donné un verbe aux Allemands : büzen,
s'imbiber ; et en anglais, to booze,
signifie boire au biberon (note de R. Burton)
11
Ou « demi-zèbre », espèce disparue au 19e siècle.
12
Les parties honteuses de (ces) jeunes filles sont cousues à la manière des
Gallas et des Somalies ; la jeune mariée est désentravée à l'aide d'un petit
couteau.
13
Apporte toujours quelque chose de nouveau.
14
Dans leurs libations (littéralement, au milieu des coupes).
15
Allusion à la femme de Putiphar (intendant et chef des eunuques du pharaon) qui,
pour tenter de séduire Joseph, le saisit par son manteau et l’attira à elle.
Pour lui échapper, Joseph abandonna son manteau et prit la fuite (Burton ne
précise pas s'il fit de même).
16
« Doux repos ».
17
Premier des califes arabes, beau-père et successeur de Mahomet.
18
Magistrat, aux fonctions à la fois civiles et religieuses.
19
Burton organisera effectivement une seconde expédition, à destination, non pas
de l'Ogaden, mais, au-delà d’Harar, de l'Éthiopie et des sources du Nil. Elle
se soldera par la tragédie de Berbera du 20 avril 1855.

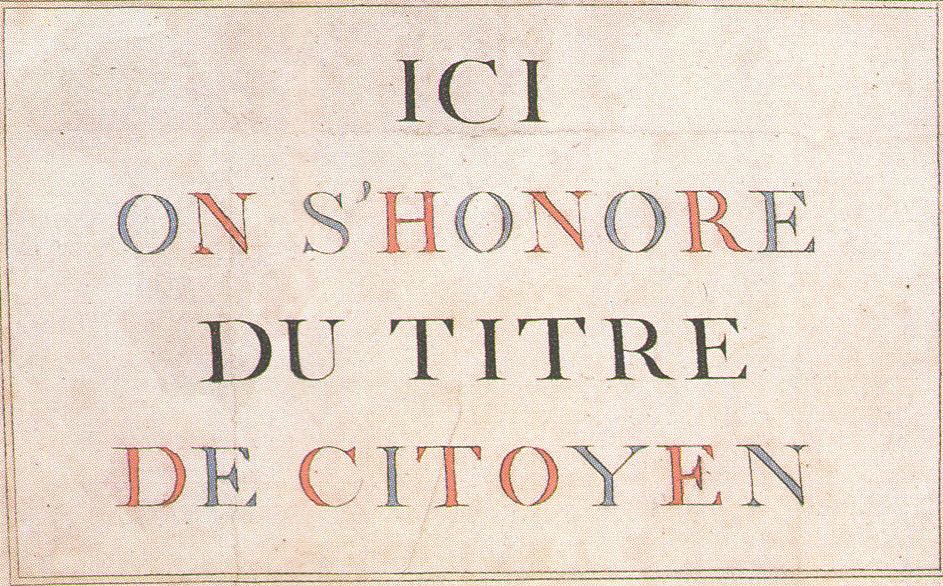







2 commentaires:
merveilleux blog
merveilleuses photos
Délicieux,délicieuses, à la rigueur...
Néanmoins, mille merci !!!
Enregistrer un commentaire